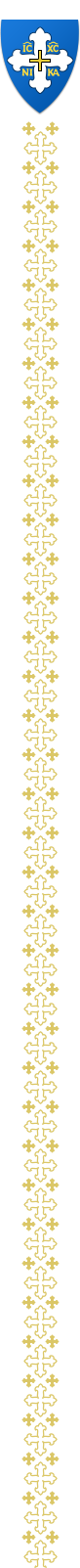LES RETOMBEES DE LA RENCONTRE DE JERUSALEM
Viimati muudetud: 06.03.2015
PAUL VI – ATHENAGORAS 1er
LES RETOMBEES DE LA RENCONTRE DE JERUSALEM
(5 et 6 Janvier 1964)
C’est avec joie que je me trouve parmi vous aujourd’hui et je vous remercie tous bien vivement de m’avoir associé à ces journées œcuméniques, dédiées au souvenir du 50e anniversaire de la rencontre à Jérusalem de leurs Saintetés le Pape Paul VI et le Patriarche Œcuménique Athénagoras, tous deux de bienheureuse mémoire.
Rencontre historique, désirée par Athenagoras déjà du temps de Jean XXIII, dont la mort trop rapide ne lui permit pas de voir sa réalisation. Rencontre historique, pour laquelle Paul VI dira par la suite au peuple des fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre lors de son retour de Terre Sainte les 5 et 6 janvier 1964 : « Vous avez compris que mon voyage ne fut pas seulement un fait singulier et spirituel : il est devenu un événement qui peut avoir une grande importance historique. C’est un anneau qui s’unit à une tradition séculaire et, qui sait, annonce le point de départ de nouveaux évènements, lesquels peuvent être grands et lourds de bienfaits pour l’Eglise et pour l’humanité » (1)
De cet événement naquit une durable et profonde amitié. Ce fut le début d’un langage nouveau et commun entre les deux « Eglises sœurs », celui des Apôtres et des Pères ; de l’expérience aussi plus que millénaire de l’Eglise indivise.
A un mois près du premier anniversaire de cette rencontre historique, le 7 décembre 1965, le dialogue de la « charité », souligné avec tant de force à Jérusalem, eut pour conséquence directe la levée des anathèmes, prononcés en 1054 de part et d’autre par le légat du siège romain, le Cardinal Humbert et le Patriarche Œcuménique Michel Cérulaire.
« Ce geste de justice et de pardon réciproque, lisons-nous dans la déclaration commune prononcée conjointement à la séance solennelle de Vatican II et à la cathédrale du Phanar, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras 1er avec son saint synode sont conscients qu’il ne peut suffire à mettre fin aux différends, anciens ou plus récents, qui subsistent entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise orthodoxe et qui, par l’action de l’Esprit Saint, seront surmontés grâce à la purification des cœurs, au regret des torts historiques ainsi qu’à une volonté efficace de parvenir à une intelligence et une expression commune de la foi apostolique et de ses exigences » (2)
Un demi-siècle plus tard, qu’en est-il au juste de l’attente de ces deux pèlerins qui, dans un même élan de l’esprit et du cœur et « les yeux fixés sur le Christ, la source d’unité et de paix », priaient ensemble au Saint Sépulcre, « afin que cette rencontre devienne le signe et le prélude des choses à venir pour la gloire de Dieu et l’illumination de son peuple fidèle » ? (3)
Pour commencer, il est bon de rappeler ici que tout récemment, à l’occasion du colloque sur « Vatican II et l’Eglise Orthodoxe » qui s’est déroulé le 21 octobre passé au Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique de Chambésy, le Pr Blaise Phidas a exprimé l’avis de revisiter la rupture de 1054 non pas comme un schisme accompli mais, à l’instar de ce qui s’était passé entre les deux Serge (1014), comme une rupture de la communion ecclésiastique. Nul doute qu’une telle approche, dans la mesure où elle serait reçue réciproquement par la conscience de nos deux Eglises, ouvrirait la voie à un possible rétablissement de la communion eucharistique, pourvu qu’il y ait, pour reprendre ce qui vient d’être lu quelques lignes plus haut, « une volonté efficace de parvenir à une intelligence et une expression commune de la foi apostolique et de ses exigences ». Ceci, afin de reconsidérer le tout du dialogue inter-religieux dans une perspective nouvelle qui prend son appui sur l’Ecriture et les Pères de l’Eglise, permettant d’aborder ensemble les interpellations brûlantes qui se posent aujourd’hui à l’Humanité toute entière, quand bien même les réponses de l’Eglise seront souvent spécifiques à sa nature propre.
Nos Eglises ressemblent un peu à ces gens qui parlent en langues différentes et c’est pour cela qu’elles ont besoin d’interprètes capables de proposer une nouvelle traduction de la Parole évangélique afin qu’Elles soient le ferment humble et paisible, le lumignon sous le boisseau pour la vie du monde. On attend d’Elles qu’Elles soient capables de prononcer ensemble, d’un seul coeur et d’une seule bouche, des paroles fortes, libres, vraies, à la mesure de la Parole qui s’est faite chair. Le vrai miracle, et ce fut le cas à Jérusalem, ne réside-t-il pas en fin de compte dans l’imprévisible dont Dieu permet la réalisation par l’intermédiaire des hommes ?
Il n’est pas dans mon intention de faire l’inventaire complet de tous les documents élaborés par la commission mixte internationale ni de commenter des textes de la plus haute importance tels que « Lumen Gentium« , cette oeuvre majeure de Vatican II. D’autres en sont bien plus qualifiés que moi. Pour ma part, je me contenterai de relever en toute simplicité que, par-delà le dialogue théologique entre les Eglises, il ne faut pas mettre entre parenthèses celui de la vie de nos Eglises en marche vers le Royaume.
Des Eglises en marche vers le Royaume « là où, selon le Document de Ravenne établi par la commission mixte internationale en 2007, il y a une communauté réunie par l’Eucharistie, présidée directement, ou à travers ses presbytres, par un évêque légitimement ordonné dans la succession apostolique, enseignant la foi reçue des apôtres, en communion avec les autres évêques et leurs Eglises ».
Nous ne doutons pas que par notre « baptême nous sommes déjà en profonde communion spirituelle, bien qu’encore imparfaite … Une communion que les hommes ne peuvent détruire car elle est plus forte que la puissance du péché », ainsi que l’a déclaré le Cardinal Kasper dans une conférence sur « l’Orthodoxie et le Catholicisme » (2004). Il n’empêche. Malgré les dons divins qui nous sont communs, il n’en demeure pas moins qu’il y a urgence de voir nos deux Eglises se rapprocher d’une manière visible pour les hommes et les femmes de notre temps. « Le fait qu’elles ne partagent plus la communion sacramentelle qui nous unissait pendant le premier millénaire ne contrevient pas seulement à la volonté de Dieu, telle qu’elle s’exprime dans la prière de Jésus à la Dernière Cène (Jean 17,21 : « afin qu’ils soient un ») ; il manifeste un grave obstacle aussi bien envers l’engagement chrétien concret dans le monde que pour la réalisation effective de notre mission, qui est de prêcher l’Evangile. » (4)
L’eucharistie constitue le cœur de l’Eglise, son centre inséparablement pascal et ultime (le dimanche, jour eucharistique par excellence, symbolise à la fois Pâques et le Huitième Jour, le jour où le temps passera tout entier dans l’éternité). En même temps, nous n’ignorons pas que le rassemblement eucharistique, lieu concret de la communion ecclésiale, ne peut se faire qu’entre des personnes conscientes de partager la même foi. La consubstantialité eucharistique des Eglises est conditionnée par l’identité de leur foi. Chacune est en effet responsable des autres, « reçoit » leur témoignage et partage avec Elles sa propre expérience.
Cependant, en dépit des actes prophétiques de rencontres et de retrouvailles remarquables, en dépit de nos dialogues et de nos échanges théologiques réciproques déjà bien avancés surtout à partir de 1993, un retour à l’unité demandera sans doute encore un certain temps : les différences théologiques qui ont principalement causé la rupture entre l’Orient et l’Occident au début du second millénaire – c’est-à-dire entre ses principaux protagonistes qui furent Rome et Constantinople – demeurent quant à elles (les deux plus importantes en ce qui nous touche directement étant celles de la primauté et du filioque), tandis que de nos jours le mouvement œcuménique dans son ensemble donne l’impression ces dernières décennies d’être entré dans un « tel temps d’hiver » qu’il n’encourage pas les chrétiens d’adhérer d’un seul coeur et d’une seule pensée à cette unique et primordiale évidence que l’Eglise est avant toutes choses un corps de communion et de liberté et non pas de contraintes juridiques ; un corps qui repose sur le fondement du dogme de la Sainte Trinité et non pas sur tel ou tel concept mondain d’autorité et de pouvoir.(5)
La rencontre de Jérusalem inaugura le dialogue d’amour. Comme le remarquait le Patriarche Athénagoras lui-même, il a contribué à vaincre l’ « hier encore tout proche et si lourd d’antagonismes » , il a permit de « revoir nos différences d’un œil pacifié ». Maintenant ajoutait-il, il faut « travailler à retrouver la situation du premier millénaire où les différences devenaient une diversité féconde dans l’unité du même calice »… Et aussi : « Catholiques et orthodoxes partagent le même mystère ecclésial. Ils doivent maintenant engager un dialogue théologique sur le fond, non pas à la suite, mais à l’intérieur du dialogue d’amour. Oui, l’union est maintenant une possibilité historique. Je ne précise pas de date. J’espère. Je combats. L’union peut se faire d’une manière inattendue, comme toutes les grandes choses, comme le retour du Christ qui a dit qu’Il reviendrait comme un voleur…L’union se fera sans doute à chaud. L’Esprit n’est pas seulement lumière. Il est feu».(6)
Ainsi parlait Athénagoras, ce grand visionnaire et prophète de l’unité, lui qui, à travers les remous tragiques des guerres et des occupations de son temps, avait découvert la souffrance et le besoin d’amour des hommes. Pour lui, le christianisme pouvait devenir le ferment de l’unité humaine et transformer l’actuelle crise de civilisation si le sens oriental de la contemplation s’unissait au sens occidental de l’histoire.
De son côté, Rome ne resta pas inactive. L’essentiel de sa démarche reste bien entendu le deuxième concile du Vatican, qui a rendu au ministère épiscopal sa pleine sacramentalité et rétabli la responsabilité synodale commune du pape et des évêques pour la conduite de l’Eglise toute entière, écartant de par la même une ecclésiologie exclusiviste. La grande contribution de Vatican II fut l’ouverture de l’Eglise de Rome vers toutes les autres Eglises et en direction du Mouvement Œcuménique, l’évêque de Rome étant appelé à « présider dans la charité » à toute la diversité des églises particulières (7) ; à manifester l’unité de l’épiscopat, l’unité de l’Eglise, sa primauté étant « un principe d’unité de la foi et de la communion » (8). Ceci explique le pourquoi des gestes spectaculaires des Eglises de Rome et de Constantinople en vue de l’unité des chrétiens ; gestes qui n’occultent pas, pour la circonstance, le « mystère » de la présence de Pierre (et aussi de Paul) à Rome et la « présidence à l’amour » qui en résulte pour l’église de cette ville, mystère pleinement reconnu par l’Orient à partir du Ve siècle. « La vraie théologie n’est pas défensive, elle ne craint pas le dialogue mais au contraire elle le recherche et le développe, parce que la relation entre ce qui est de la tradition et ce qui relève de l’actualité à l’égard du monde contemporain est la garantie même du travail théologique » (9).
Aussi, lorsque Paul VI se rend le premier à Istanbul en juillet 1967, il pose là un authentique signe de conversion qui a pour seul but la réconciliation, d’Eglise sœur à Eglise sœur, sans prétention juridictionnelle aucune. Après quoi, la voie sera libre pour Athénagoras de se rendre à Rome sans que sa visite ne soit perçue comme un geste de soumission. Incontestablement, Paul VI a engagé avec l’Orthodoxie un dialogue en profondeur, qui ne restera pas sans lendemains. La logique de la générosité entre les deux Eglises sœurs venait enfin de l’emporter sur celle de la domination. C’est en tous cas ce qui ressort clairement de la lecture du « Tomos Agapis », lieu théologique par excellence de référence quant à nos relations réciproques tant pour aujourd’hui que pour demain.
Tous nous gardons dans nos mémoires cet événement unique du mois de mars 1971, au cours duquel Paul VI, après lecture de la déclaration du Patriarche Athenagoras le qualifiant de «frère aîné » , «héraut et artisan éminent de la paix, de l’amour et de l’unité des chrétiens… » (10), se jeta par un geste spontané aux pieds de l’émissaire patriarcal, le Métropolite Meliton et les embrassa. Athénagoras a toujours rappelé que le mystère même de la primauté romaine n’est pas mis en cause par les orthodoxes, seulement certaines de ses modalités modernes. C’est ce que vient d’indiquer à son tour , il y a quelques jours au micro de Radio Vatican, le cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil pontifical pour la culture, lorsqu’il dit à propos de la primauté : « le point sur lequel nous avons à nous rapprocher, c’est la manière de vivre ce ministère (11).
Déclaration d’autant plus actuelle qu’elle nous place dans l’attente de résultats concrets, à la fin des pourparlers que mène en ce moment le Pape François avec la commission des huit prélats auxquels il a confié une mission de réflexion et de propositions concernant un fonctionnement plus collégial, plus « synodal » selon la terminologie orthodoxe, avec l’ensemble des évêques au sein de sa propre Eglise.
Le véritable dialogue, non plus seulement « de la charité » mais proprement théologique, s’est enfin engagé en 1980 sous Jean-Paul II. Depuis une grande commission mixte, réunie périodiquement, a élaboré d’importants documents, notamment sur la structure sacramentelle de l’Eglise. Le premier de ces documents, issu du dialogue théologique international entre les Eglises catholique et orthodoxe porte pour titre : « Le mystère de l’Eglise et de l’Eucharistie à la lumière de la Sainte Trinité »(1982). Ce document, comme tant d’autres qui lui feront suite, indique que l’unité de l’Eglise est comprise comme une unité de communion selon le prototype de l’unité trinitaire.
Plus près de nous, paroles et actes se sont multipliés. Citons entr’autres le document de Balamand, qui rejette le prosélytisme (1993) ; la grande Encyclique sur l’œcuménisme « Ut unum sint » et la lettre apostolique « Orientale Lumen » (1995) qui témoignent d’une volonté de rapprochement et de convergence ; le « Document de Ravenne » (2007) de la Commission internationale mixte, dans lequel nos deux Eglises reconnaissent aussi les différentes formes de primauté : « la primauté, à tous les niveaux est une pratique fermement fondée dans la tradition canonique de l’Eglise », même s’ « il existe des différences de compréhension concernant la manière dont cette primauté doit être exercée et également concernant ses fondements scripturaires et théologiques ». A partir de cette évidence, le rôle de l’évêque de Rome devra un jour être défini avec soin, à la fois en continuité avec les anciens principes structurels du christianisme et en réponse au besoin d’un message chrétien unifié dans le monde d’aujourd’hui. « Dans la crainte de Dieu, la sincérité et la prudence », précise le Patriarche Bartholomée, sans quoi on ne peut avancer vers l’unité (12).
A Rome, les 25-27 juin 1995, Jean-Paul II et Bartholomée tombèrent d’accord pour affirmer que l’exercice de la primauté n’a de sens que comme service et exige la plus grande humilité. Mais le patriarche a souligné combien l’exégèse de Mt 16 avait été et restait complexe et controversée et le pape n’a pas dit grand chose sur le moment. C’est finalement avec l’encyclique « Ut unum sint » qu’il proposera une réflexion œcuménique sur la mise en œuvre de la primauté. Douze ans plus tard, le Document de Ravenne et les rencontres qui lui firent n’ont abouti à aucune proposition concrète susceptible de satisfaire les parties en présence. Gardons toutefois dans le secret de notre être intérieur cette phrase qu’aurait prononcée Jean-Paul II dans un entretien privé : « Ce que je souhaite avec les orthodoxes, c’est la communion, ce n’est pas la juridiction » (13).
Qu’importe après tout pour le moment ? La cicatrisation a déjà commencée, non pas seulement dans les cœurs, mais aussi à petits pas dans les structures mêmes de nos Eglises. Du côté de l’Eglise orthodoxe un grand mérite revient au patriarche Bartholomée lequel, par son rejet de toutes les réactions des intégristes orthodoxes d’où qu’ils viennent, a su faire face en toutes circonstances à ce qu’il a nommé « l’hystérie anti-catholique ». Sa présence à Rome lors des funérailles de Jean-Paul II et plus encore son initiative, qui a surpris tout le monde, d’assister en personne à l’intronisation du Pape François témoignent sans conteste de sa forte vision et de sa totale conviction de l’unité.
Le 15 novembre de cette année eut lieu à l’Ecole de Théologie de l’Université de Berne un colloque sur le thème de la procession du Saint Esprit sous le titre « l’enseignement de la Théologie trinitaire et le Filioque à propos de la controverse entre Orient et Occident au 9e siècle ». Un tel colloque est, de nos jours, totalement opportun lorsqu’on se rend compte de ce que représente le mystère de la Sainte Trinité dans l’ensemble de la vie de l’Eglise du Christ.
Encore une fois, le cadre de notre rencontre n’est pas propice pour un long développement historique et théologique sur cette controverse qui, selon Nicolas Lossky, a été, qu’on le veuille ou non, la raison majeure de la séparation entre l’Orient et l’Occident puisque, d’après lui, toutes les autres divergences ont accompagné ou suivi la première dispute sur le Filioque. Dispute qui, au concile convoqué à Constantinople en 879-880 pendant le pontificat du patriarche Photius et avec la participation des légats du pape Jean VIII, se solda par la proclamation immuable du texte du Credo sans le Filioque.
Dans sa conférence déjà citée sur l’ « Orthodoxie et l’Eglise catholique », le Cardinal Kasper précise, à propos de l’expression latine ajoutée au Credo de Nicée, qu’il ne s’agit pas d’une différence qui peut être cause de division entre les Eglises, mais d’une « déclaration complémentaire ». Là, où, en revanche, il est indiscutable que l’ajout du Filioque par les latins fait problème, c’est qu’il le fut de façon unilatérale, c’est-à-dire en dehors d’un concile œcuménique. C’est sans doute pour cette raison que la Commission théologique orthodoxe-catholique d’Amérique du Nord, réunie à Saint Paul’s College de Washington le 25 octobre 2003, recommanda ceci : que l’Eglise catholique, en raison de la valeur normative et dogmatiquement irréformable du Credo de 381, n’utilise que le texte grec original dans ses traductions pour usage catéchétique et liturgique (n°7) : que l’Eglise catholique, suite à un consensus théologique grandissant et en particulier suite aux paroles de Paul VI, déclare que la condamnation du 2e Concile de Lyon (1274) de « ceux qui ont l’audace de nier que le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils » ne s’applique plus (n°8). Et de conclure de la manière suivante : « Nous proposons ces recommandations à nos Eglises, convaincus que nous sommes – grâce à une étude et des échanges intensifs – que les manières différentes de nos traditions de comprendre la procession du Saint-Esprit, ne doivent plus nous diviser. Nous croyons plutôt que notre profession de l’antique Credo de Constantinople doit pouvoir devenir, grâce à un même usage et à nos nouvelles tentatives de compréhension réciproque, le fondement d’une unité plus consciente dans la foi commune, que toute théologie essaie simplement de clarifier et d’approfondir… ».
De fait, en 1974, à l’occasion du septième centenaire du concile de Lyon, un concile d’union manquée, Paul VI distingua clairement les véritables conciles œcuméniques, c’est-à-dire les sept tenus en commun par l’Orient et l’Occident au premier millénaire, et les conciles « généraux », réunis par l’Eglise latine après la séparation, et qui ne valent que pour elle : affirmation reprise à plusieurs reprises depuis par le cardinal Ratzinger, qui devint par la suite Benoit XVI (14).
Dans son allocution adressée le 29 juin 1995 au patriarche Bartholomée, Jean-Paul II, à propos du Filioque, avait affirmé : « Le Père, comme source de toute la Trinité, est la seule origine du Fils et de l’Esprit » et dans la « Note doctrinale » du 13 septembre 1995 concernant la procession du Saint-Esprit, il est écrit : « Le Saint-Esprit tire son origine du Père seul de manière principielle, propre et immédiate ».
Tout ceci montre qu’il est possible d’envisager dans le futur une recherche dans une perspective commune. Peut-être en chargeant une nouvelle commission internationale mixte, au sein de laquelle catholiques et orthodoxes auraient pour mission unique de mettre en lumière tous les points de réelle convergence entre deux méthodes théologiques aux approches différentes. L’Occident en effet part de la nature une pour considérer ensuite les Trois Personnes ; l’Orient part des Trois personnes pour considérer ensuite la nature une (15).
A condition bien entendu que cette commission ne s’enferme pas dans une discussion stérile entre le monopatrisme et le filioquisme et qu’elle dépasse tout climat passionnel dans le but exclusif de reconsidérer ensemble ce qui se cache au centre même d’une certaine imprécision dogmatique, à savoir les rapports réciproques entre le Fils et l’Esprit.
Par ailleurs, la dialectique causale doit laisser place à la dialectique de la Révélation du Père par le Fils dans l’Esprit Saint. En clair, il importe non pas de relever les relations entre le Père et l’Une des Deux Personnes mais il s’agit de manifester les relations de Celui qui se révèle et de ceux qui le révèlent. « C’est ici, dit le Pr Paul Evdokimov, que la formule per Filium (dia tou Yiou) signifie et explique que le Filioque ne peut être orthodoxe qu’en étant équilibré par la formule correspondante du Spirituque » (16).
Aujourd’hui donc, en retrouvant la théologie des Pères et en cherchant une synthèse néo-patristique, il convient de dépasser la notion de cause, de dépendance causale qui présente un anthropomorphisme inapplicable au mystère de Dieu et ne trouve aucune référence dans les Ecritures.
En conclusion, je ne vois pas qu’il faille nécessairement toucher au texte du Credo de Nicée-Constantinople ; je serai plutôt d’avis de l’entourer d’un commentaire théologique afin qu’il puisse être confessé d’une même voix par un Occident et un Orient réconciliés. Telle sera le sens de cette union : non pas pour nous confondre mais pour nous contenir réciproquement.
En attendant, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Pour que progresse la cause de l’unité, il nous faut chercher à établir une authentique et active collaboration.
J’adhère pour ma part pleinement à cette proposition du pape émérite Benoit XVI de développer ensemble « une pastorale fructueuse de communion » par laquelle nous pourrions dire au monde que « le Christ n’est pas une institution ; qu’Il est, pour ceux qui souffrent, valeur, acte, transformation des cœurs dans le sens de la douceur, de la simplicité, de l’humilité » (17). Une pastorale de communion grâce à laquelle la foi chrétienne pourra rester, dans notre société sécularisée, une authentique pastorale de communion susceptible de mettre l’homme devant « ce qui ne sert à rien » mais qui éclaire tout parce qu’il existe encore des réalités secrètes que l’on ne peut ni expliquer, ni acheter, mais seulement contempler et admirer ; une pastorale de communion qui devrait permettre à l’homme de saisir son existence comme une célébration, comme une fête ; où il pourra enfin trouver une parole, des images et des gestes de vérité, même si l’histoire folle de ce début du XXIe siècle semble sans cesse le faire taire.
Enfin, une pastorale de communion qui, en ne se situant prioritairement qu’au seul niveau des légitimations ultimes, devrait permettre de faire réfléchir la société et de lui rappeler sa responsabilité et son sens de l’amour, sans se laisser enfermer dans cette fascination par la mort que désormais elle ne cesse de secréter, engendrant de cette façon une sorte d’angoisse du crime, contre l’autre ou contre elle-même.
Tout ceci pour mieux nous faire comprendre que Dieu est la liberté de l’Homme ; qu’Il est ce « Quelqu’un » qui s’interpose à jamais entre le néant et nous ; néant qui engendre, de jour en jour, tant de terreur et se monnaie en une multitude de peurs. On y accède par la foi mais plus encore par le fait que l’activité pastorale possède les moyens de déclencher les vrais efforts de croissance spirituelle, tant individuelle que collective.
A quel prix et avec quelles chances ? A nous de les inventer à travers toutes les formes de beauté, de rencontres, d’échanges et de conversations d’homme à homme, sans attendre pour autant des résultats spectaculaires, immédiats et massifs.
+STEPHANOS, métropolite de Tallinn et de toute l’Estonie
Lungro de Calabre, les 23-25 novembre 2013.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) – « TOMOS AGAPIS » (Le Livre de l’Amour ou de la Charité) – Ed. conjointe – Rome/Istanbul 1971, p.122
(2) – Tomos Agapis, loc.cit., p.280
(3) – Tomos Agapis, loc.cit., p.120
(4) – Consultation théologique entre orthodoxes et catholiques d’Amérique du Nord, Washington, le 2 octobre 2010
(5) – Patriarche Bartholomée : « A la rencontre du Mystère » – Ed. du Cerf, Paris 2011, p.45
(6) – Olivier Clément : « Dialogues avec le Patriarche Athénagoras » – Ed. Fayard, Paris 1969, pp.430-449
(7) – Lumen Gentium n°26
(8) – Lumen Gentium n°18
(9) – Message du Patriarche Bartholomée pour la rencontre sur Vatican II de Chambésy-Genève, le 21 octobre 2013
(10) – Tomos Agapis, loc.cit.,p.413
(11) – in ZENITH du 12 novembre 2013
(12) – Olivier Clément : « Rome autrement » – Ed. DDB, Paris 1997, pp.97 et suivantes
(13) – Olivier Clément : « Rome autrement », loc.cit.,p.106
(14) – Olivier Clément : « Rome autrement »,loc.cit.,p.96
(15) – Jusqu’à la fin du VIIIe siècle, les Pères orientaux expliquent le « Filioque » latin en ce sens : « Ils ont démontré qu’ils ne tiennent pas le Fils pour cause du Saint-Esprit car ils savent que le Père seul est la cause du Fils et de l’Esprit, de l’un par la génération, de l’autre par la procession ; mais ne font que montrer que l’Esprit procède par le Fils, en indiquant ainsi la conjonction et la similitude parfaite de la substance » (Cyrille d’Alexandrie, PG XCI, 136 A,B). Saint Maxime le Confesseur ne voit pour sa part aucune déviation susceptible d’amener un schisme.
(16) Il apparaît évident en effet, du point-de-vue de l’Orient que le filioquisme ne peut trouver sa place que sur le plan de la manifestation. Ainsi, le « per Filium » signifie que le lien n’est pas « causal » mais d’interdépendance et de réciprocité. La distinction fondamentale pour l’Orient est que l’Esprit reçoit sa subsistance du Père (cause de l’Esprit) mais il subsiste par le Fils et même du Fils (raison d’être de l’Esprit). L’Esprit dès lors, dans sa procession hypostatique procède du Père seul et sur le plan de la manifestation, il manifeste éternellement la vie divine du Père par le Fils. Voir aussi dans son intégralité le livre de Paul Evdokimov : « »L’Esprit Saint dans la tradition orthodoxe », Bibliothèque oecuménique n°10, Ed.du Cerf, Paris 1970.
(17) – Georges Khodr : « L’appel de l’Esprit » – Ed. du Cerf/Le Sel de la Terre, Paris 2001, pp.321 et 322