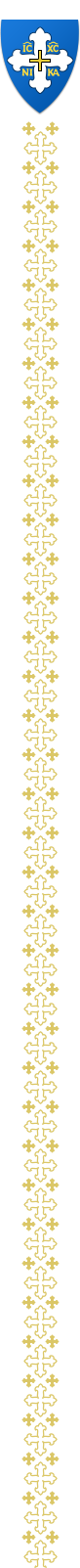LE PATRIARCAT ŒCUMENIQUE AU SERVICE DE L’UNITE ORTHODOXE ET DE L’UNITE CHRETIENNE
par Olivier Clément
Supplément au SOP N°236, mars 1999
Pour évoquer le service de l’unité auquel se voue, aujourd’hui plus que jamais, le patriarcat œcuménique, je rappellerai d’abord quelques données historiques, puis les efforts réalisés à notre époque, notamment par Athénagoras 1er, enfin le combat actuel que mène Bartholomée 1er.
Byzance devint Constantinople en 330 et l’empereur Théodose, à la fin du 4ème siècle, y fixa définitivement la capitale de l’Empire romain, c’est-à-dire selon les conceptions de l’époque, de l’empire universel, «œcuménique». Empire qui allait subsister mille ans en Orient, alors qu’il s’effondrait en Occident dès 476.
L’évêque de Constantinople gagne ainsi une autorité exceptionnelle. Le 3ème canon du concile de 381 fait de lui un témoin et un recours après Rome car Constantinople est l’«autre Rome» alter Roma.
Le 4ème concile œcuménique, celui de Chalcédoine, tenu en 451, précise ce «privilège d’honneur» comme un droit d’appel, fixe le ressort propre de Constantinople et dans son 28ème canon justifie la prééminence de ce siège par sa présence dans la capitale où se trouve l’empereur et le sénat. Rome proteste, affirmant que toute primauté doit avoir un fondement apostolique, plus précisément pétrinien, et non un fondement simplement «politique». En réalité, faut-il le rappeler, la capitale avait une valeur symbolique de centre cosmique et d’anticipation de la Jérusalem nouvelle. Quoi qu’il en soit, le 28ème canon fut suspendu, mais ne tarda pas à entrer dans les faits et, dès le 6ème siècle, fut reçu aussi bien en Orient (dans le Syntagma) qu’en Occident (dans la Prisca).
A la fin du 5ème siècle, l’Empire «œcuménique» ayant disparu en Occident mais subsistant en Orient, le patriarche de Constantinople (on parlait en effet désormais de «patriarche») prit le nom, qu’il garde encore aujourd’hui, de «patriarche œcuménique». Il devint alors le gardien de la structure conciliaire de l’Eglise que symbolisait l’uni-diversité de la «Pentarchie», ces cinq grands patriarcats qui correspondaient à des aires de civilisation : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem.
Mais bientôt l’invasion de l’islam fait de la Pentarchie un fantôme. Rome et Constantinople, restées face à face, s’affrontent au 9ème siècle avec la crise photienne, se réconcilient en 880, mais ensuite s’éloignent l’une de l’autre (the Dark ages pour Rome, l’orgueilleuse apogée politique et culturelle pour Byzance). Lorsque se précise, de 1054 à1204, la séparation de l’Orient et de l’Occident chrétiens, Constantinople assume en Orient le rôle qui était celui de Rome aux premiers siècles : «manifester à toutes les saintes églises de l’univers sollicitude et attention», défendre et préciser les règles de foi (par exemple avec les conciles palamites du 14ème siècle), exercer un droit d’appel et de secours (ainsi pour les patriarches d’Antioche, réfugiés à Constantinople à l’époque des croisades et des Etats latins du Levant).
Sans pour autant durcir l’opposition avec Rome, à la fois reconnue dans son charisme et refusée dans ses excès : «C’est à Pierre, non à un autre mais à lui seul, que le Seigneur a confié la présidence sur toutes les brebis de l’univers» (PG 124, 303 A). Et au 12ème siècle, Nicodème, métropolite de Nicomédie : «L’Eglise de Rome, à laquelle nous ne refusons pas la primauté parmi ses sœurs (…), s’est elle-même séparée, par suite de ses prétentions. Si le pontife romain (…) veut fulminer contre nous et nous lancer des ordres (…), s’il veut juger nos églises, selon son seul avis, quelle fraternité, et même quelle paternité pourrait-il y avoir en cela?» (Dialogues, PL. 188, 1219).
Les conciles d’union de Lyon (1274) et de Florence (1439), où le patriarche cède aux Latins à la demande instante d’un empereur aux abois sont rapidement rejetés : l’union de Lyon par le concile de 1285 où le patriarcat encourage la recherche d’un dépassement et d’une conciliation sur le problème du Filioque, l’union de Florence par le concile de 1454 (confirmé en 1484), dans le cadre nouveau, il est vrai, de l’Empire ottoman.
Avec la chute de Constantinople en 1453, le patriarche est en effet à la fois isolé et confirmé. Isolé, car le sultan redoute tout rapprochement avec la papauté, qu’il considère comme la tête de l’Occident ennemi. Confirmé, car le patriarche est nommé «ethnarque» du millet orthodoxe, c’est-à-dire chef de la «nation» chrétienne au sens musulman pour lequel le religieux et le civil sont inséparables.
Dans ce nouveau contexte, la primauté fonctionne utilement jusqu’au début du 19ème siècle. Le patriarche réunit en concile ses collègues orientaux et leurs synodes, chaque fois que se pose un problème grave. Les conciles du 16ème siècle règlent l’instauration d’un patriarcat russe, ceux du 17ème situent l’orthodoxie entre Réforme et Contre-Réforme. Au 18ème siècle, il faut faire face à l’offensive romaine – prosélytisme, uniatisme, rebaptisation alors que jusque là la communicatio in sacris persistait de manière sporadique.
Au 19ème siècle, le mouvement des nationalités, qui triomphe en Europe occidentale, gagne irrésistiblement les Balkans. Chaque nation devenue Etat instaure d’autorité son indépendance ecclésiastique, détache son Eglise du patriarcat œcuménique pour qu’elle se déclare «autocéphale». Le fondement ecclésiologique de l’orthodoxie semble devenu ethnique et national.
Au même moment, et pour se protéger du même mouvement et de l’assaut de la modernité, l’Eglise catholique s’enferme dans la forteresse de l’infaillibilité et de la juridiction immédiate du pape sur tous les fidèles, l’une et l’autre proclamées en 1870 par le premier concile du Vatican.
Le patriarcat œcuménique fait face lucidement à ces deux problèmes. En 1848, lorsque Pie IX appelle les orthodoxes à se rallier à Rome dans une perspective qui est déjà celle de Vatican 1, Constantinople convoque les patriarches orientaux (sans oublier, semble-t-il, mais ce point est controversé, le saint-synode de l’Eglise russe) et publie une encyclique affirmant que la vérité ne peut être sauvegardée que par le peuple tout entier, les évêques comme «juges», les simples fidèles comme «boucliers».
En 1872, un semblable concile réuni à Constantinople condamne avec beaucoup de fermeté le phylétisme, c’est-à-dire le nationalisme ecclésiastique par lequel «le dogme de l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique reçoit un coup mortel».
Après quoi, et jusqu’aux lendemains de la première guerre mondiale, rien ne se passe : de nouveaux appels de Rome notamment en 1894, sont repoussés. Quant à la proposition faite par le patriarche Joachim III, en 1902, que toutes les Eglises autocéphales se rencontrent et se consultent tous les deux ans, elle n’obtient aucun écho.
A la suite de la première guerre mondiale, l’Empire ottoman s’effondre, une nation turque émerge du chaos, les Grecs, engagés dans une folle expédition en Asie Mineure, sont vaincus, l’«échange des populations» réduit à l’extrême, en Turquie même, le nombre des fidèles du patriarcat, réduction que la crise de Chypre aggravera encore. La chance du patriarcat, c’est d’obtenir alors juridiction sur la diaspora grecque dans le monde, diaspora particulièrement importante aux Etats-Unis. Le système du millet a disparu (sauf la clause qui permet au gouvernement turc de rayer qui il veut de la liste des éligibles lors de l’élection d’un nouveau patriarche). Le traité de Lausanne, en 1923, garantit la situation du patriarcat à Constantinople mais ne dit rien de son rôle hors des frontières de la Turquie. Ce qui permettra à celle-ci de fermer en 1971 l’école internationale de théologie de Halki.
Durant l’entre-deux-guerres, Constantinople prend sous sa protection la plupart des fragments de l’Eglise russe qui se trouvent, soit par le nouveau découpage des frontières, soit par émigration, hors du territoire soviétique. Dénoncé par Moscou, déçu par l’attitude d’abord ouverte puis nettement unioniste de Rome, le patriarcat se rapproche du monde anglican et protestant. Par l’encyclique de 1920, il devient co-fondateur du mouvement œcuménique. Au lendemain de la seconde guerre mondiale où la Turquie est restée neutre, il participe, en 1948, à la conférence d’Amsterdam qui fonde le Conseil œcuménique des Eglises. Constantinople doit alors faire face au patriarcat de Moscou qui, la même année, dans un vaste rassemblement des orthodoxes des pays de l’Est, dénonce le Conseil comme un instrument du capitalisme universel. On peut le dire : Constantinople a sauvé alors le Conseil œcuménique en préservant son caractère multiconfessionnel. Lorsque, dans les années 60, s’ébauche entre l’Est et l’Ouest une politique de «détente», c’est encore Constantinople qui, à la conférence de New-Delhi, en 1961, assure l’entrée dans le Conseil œcuménique de la plupart des Eglises du monde communiste.
A partir de 1953, tout se précise et s’accélère grâce au patriarche Athénagoras 1er. A l’intérieur comme à l’extérieur de l’orthodoxie.
A l’intérieur, Athénagoras entreprend de réinventer la primauté dans un contexte qui n’est plus celui de la Pentarchie, mais de la multiplicité des autocéphalies. Constantinople apparaît comme un centre d’intercession pour la sauvegarde de la foi et l’union de toutes les Eglise orthodoxes. La primauté ne peut signifier désormais qu’une offre sacrificielle de service. Son rôle est d’initiative, de coordination, de présidence, mais toujours après avoir sollicité et obtenu l’accord des Eglises-sœurs, selon les deux principes de leur concilierait et de non-intervention dans leurs affaires intérieures.
A partir de 1961, Athénagoras parvient à réunir une série de conférences panorthodoxes (notamment dans l’île de Rhodes), conférences où malgré toutes les tensions politiques, éclate ce qu’on a appelé «le miracle de l’unité». Le grand patriarche rend visite, dans une réelle ferveur, à presque toutes les Eglises autocéphales, y compris dans les Balkans, à celles qui se trouvent à l’Est du «rideau de fer» (mais déjà la Russie se raidit et refuse de l’accueillir). Il crée à Chambésy, près de Genève, un centre de rencontre et de réflexion, où il installe un secrétariat préconciliaire, car il désire placer cet effort de rassemblement dans une telle perspective, non qu’il croie à la possibilité rapide d’un concile, mais, comme il le disait, pour faire «fermenter la fraternité orthodoxe».
L’essentiel, cependant, c’est le dialogue admirable engagé avec Rome par Athénagoras, malgré les réticences des Eglises de l’Europe du Sud-est et particulièrement de l’Athos où le patriarche dut aller se justifier en 1963, avec un succès relatif, au moment même où le second concile du Vatican retrouve le ministère de l’évêque comme «ordinaire», «immédiat», exercé «personnellement au nom du Christ» et définit l’Eglise universelle comme une communion d’Eglises locales dont chacune se fonde sur l’eucharistie.
Lorsqu’il apprend que Paul VI va se rendre à Jérusalem, Athénagoras suggère que tous les responsables des Eglises chrétiennes y viennent aussi «pour demander, dans une commune et fervente prière, à genoux, les larmes aux yeux, et dans l’esprit d’unité, sur le Golgotha qui a été arrosé par le sang très saint du Christ, et devant le sépulcre de celui dont jaillirent la réconciliation et la pénitence, que s’ouvre pour la gloire du saint Nom du Christ et pour le bien de toute l’humanité la voie d’un rétablissement complet de l’unité chrétienne, selon la sainte volonté du Seigneur». Projet qui parut utopique, mais la rencontre du pape et du patriarche, elle, ne l’était pas. En janvier 1964, les deux hommes échangent le baiser de paix à Jérusalem. Un an plus tard les anathèmes lancés en 1054 sont levés.
Un long dialogue s’engage alors entre Athénagoras et Paul VI, entre qui on sent grandir l’amitié. Ce dialogue a été consigné dans le Tomos Agapis, «le livre de l’Amour» ou «de la charité», publié simultanément en 1971 par le Phanar et le Vatican. Paul VI y met l’accent sur l’église locale comme communauté eucharistique, Athénagoras reprend l’expression d’Ignace d’Antioche qu’une «présidence à l’amour» est dévolue à l’église de Rome. Et malgré les déviations médiévales et modernes le charisme pétrinien de ce siège subsiste, affirme le patriarche.
La fin du pontificat d’Athénagoras 1er fut assombrie par le retour en force, autour surtout de l’éternelle rivale, Moscou, et des églises slaves, de l’autocéphalisme absolu (il faudrait aux assemblées panorthodoxes une présidence tournante) et de la méfiance antiromaine. Tout se stabilise et s’immobilise avec le successeur, humble et effacé d’Athénagoras, Dimitrios 1er.
C’est donc le rôle du patriarche actuel, Bartholomée ler, qu’il nous faut examiner pour finir.
Le patriarche Bartholomée a une excellente connaissance, par l’intérieur pourrait-on dire, des confessions occidentales. Il a étudié trois ans à la Grégorienne, à Rome, et c’est là qu’il a élaboré et soutenu sa thèse de droit canon. Puis il a approfondi la pensée protestante à l’Institut œcuménique de Bossey, près de Genève. Il a été membre, et même pendant huit ans, vice-président de la commission du Conseil œcuménique intitulée «Foi et Constitution», la seule du Conseil où les catholiques sont représentés à part entière.
En même temps, collaborateur du métropolite Méliton puis du patriarche Dimitrios 1er, il faisait l’apprentissage de l’orthodoxie dans toute sa complexité. Lorsqu’il fut élu patriarche en novembre 1991, il précisa sa vision de la primauté dans son discours d’intronisation. D’emblée, il la définit comme participation à la Croix du Christ, pour «le service et le témoignage de l’orthodoxie», dans l’entier respect de la «conciliarité à travers laquelle l’Esprit parle à l’Eglise». Puis, il dit «son baiser de paix et d’amour» aux primats des Eglises non-chalcédoniennes – «dont la foi est si proche de la nôtre» -, au pape, aux primats de l’Eglise anglicane et de l’Eglise vieille-catholique, aux responsables de toutes les autres communautés chrétiennes et particulièrement du Conseil œcuménique des Eglises.
Dès mars 1992, pour le dimanche de l’orthodoxie, il rassemble au Phanar une «synaxe» des primats orthodoxes. «Ils se découvrent face à face, dit-il, échangent le baiser de paix et d’amour, partagent la Coupe de la Vie (… ), recevant ainsi de Dieu le don de l’unité orthodoxe». Tous affirment leur volonté d’affronter «comme un seul corps» les problèmes d’aujourd’hui…
Mais dans les années suivantes, vers 1995, il se heurte à deux difficultés aujourd’hui mal surmontées : d’une part les relations avec Moscou, de l’autre le profond malaise que la collaboration d’une partie de l’épiscopat avec le régime totalitaire a provoqué dans beaucoup d’Eglises. Avec Moscou, la crise a cristallisé en 1995-96 sur la situation de l’Eglise d’Estonie. Autonome sous la protection de Constantinople dans l’entre-deux-guerres, intégrée après 1940-45 dans le patriarcat de Moscou, cette Eglise tente aujourd’hui de se reconstituer, mais elle se divise, les Soviétiques ayant largement russifié le pays. D’où le conflit entre Constantinople et Moscou, de sorte que le patriarche russe n’est pas venu à la synaxe tenue à Patmos à la fin de septembre 1995. Surmontée en mai de l’année suivante, la crise pourrait renaître à propos de l’Ukraine où la situation reste chaotique.
En Bulgarie d’autre part, le malaise que j’évoquais tout à l’heure est allé jusqu’au schisme. Au début d’octobre 1998, une troisième synaxe, au complet cette fois, s’est réunie à Sofia. Le schisme a été effectivement surmonté mais la logique de désintégration est telle qu’il recommençait dix jours plus tard.
Tout cependant n’a pas été vain dans ce dur combat du patriarcat œcuménique pour manifester l’unité orthodoxe. Deux acquis subsistent : d’une part la pratique des synaxes qui rassemblent, pour une réflexion et une action communes, tous les primats des Eglises autocéphales ; d’autre part, dans les pays de la diaspora où se juxtaposaient les juridictions, la formation d’Assemblées d’évêques sous la présidence du représentant de Constantinople. En France, cette Assemblée, vient de fêter son premier anniversaire.
Dans le domaine œcuménique, Bartholomée fait face, tant bien que mal, à la poussée d’intégrisme anti-occidental qui enfièvre actuellement la plupart des Eglises orthodoxes… Crainte de la modernité dont on ne veut voir que les aspects négatifs, refus des sous-produits de la culture américaine, maladresses des confessions occidentales, poussée des sectes et maintenant, de plus en plus, du bouddhisme et de l’islam d’où l’exaspération des nationalismes, tout explique ce repliement, voire cette agressivité. A quoi s’ajoute l’influence d’une sorte d’internationale millénariste qui va de certains monastères athonites et des vieux calendaristes grecs à l’aile droite de l’Eglise russe-hors-frontières, maintenant présente en Russie même, en passant par le soi-disant patriarche de Kiev Philarète et ses succursales en Occident, sans oublier certains évêques serbes.
Bartholomée a maintenu jusqu’à l’été 1993 le travail de la grande commission mixte orthodoxe-catholique. Cette année-là, à Balamand, dans le nord du Liban, cette commission a élaboré un texte décisif où les deux «Eglises-soeurs» ont trouvé un accord sur le problème de l’uniatisme : les catholiques renonçant solennellement à celui-ci, les orthodoxes s’engageant à tolérer momentanément les communautés grecques catholiques. Le patriarche veut aller plus loin : il favorise le «groupe de Kiev» qui réunit des théologiens grecs-catholiques et orthodoxes et cherche les voies d’une intégration mutuelle, que souhaitent aussi les uniates du Proche-Orient.
Mais l’accord de Balamand, sans parier de ces prolongements encore discrets, n’a été accepté ni par toutes le Eglises orthodoxes, ni par toutes les Eglises grecques-catholiques. Et depuis 1993, la grande commission mixte n’a pas pu se réunir.
Pire : le patriarche lui-même a dû partiellement céder à ses intégristes sur le problème de la primauté romaine. Depuis deux ans, et malgré des visites ferventes à Rome, il n’a cessé d’affirmer que rien dans les Evangiles ne fonde cette primauté. Et certes rien dans les Evangiles ne justifie les Didactus papae de Grégoire VII, ni le dogme de 1870, ni l’Etat du Vatican, mais la vocation de Pierre est clairement dessinée, comme l’affirmait le Tomos Agapis. Il est regrettable que devant la mobilisation anti-romaine de l’orthodoxie les ouvertures de Jean-Paul Il – Orientale Lumen, note sur le Filioque, appel à étudier ensemble les modalités d’exercice de la primauté – aient été à ce point ignorées.
Du côté du monde protestant, le patriarche n’a pu empêcher l’assaut en règle contre le Conseil œcuménique, ni le retrait total ou partiel de plusieurs Eglises orthodoxes.Il est trop tôt pour mesurer les conséquences de la récente Assemblée générale d’Harare. Peut-être, comme en 1948, Constantinople sauvera-t-elle la participation orthodoxe au Conseil.
Le destin de Bartholomée 1er est aujourd’hui un destin tragique. Quoi qu’il arrive, nous sommes sûrs d’une chose, c’est qu’il continuera de lutter, et ici, je le cite, «pour une conscience ecclésiale libre de toute structure idéologique et d’un retrait inerte dans un formalisme institutionnel». Dans cette lutte entre la foi et le destin, il nous reste à aimer et à aider ce grand patriarche : pour la foi, contre le destin.