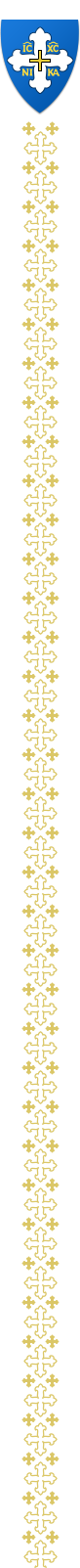LE PARTIARCAT DE CONSTANTINOPLE
par Olivier Clément
Le grand historien de l’Eglise ancienne, Eusèbe de Césarée, note que l’apôtre André, frère de Pierre et « premier appelé », évangélisa les rives européennes du Pont-Euxin (c’est-à-dire de la Mer Noire).C’est lui qui selon une tradition symbolique, aurait fondé l’église de Byzance. Saint Jean Chrysostome qui fut, au début du 5ème siècle, archevêque de Constantinople, célèbre en celle-ci « la ville des apôtres », ajoutant : « voilà ce que fait celle qui reçut un tel fondateur ». Le prestige de la cité cependant survint avec la transformation de Byzance en Constantinople, la ville de l’empereur Constantin qui fixa dans cette « nouvelle Rome » la capitale de l’empire. L’inauguration officielle eut lieu le 11 mai 330. Un des successeurs de Constantin, Théodose, qui assura la victoire de la foi de Nicée et permit la réunion du deuxième Concile Œcuménique, fixa définitivement sa résidence à Constantinople, déjà dotée de toutes les institutions civiles de l’ancienne Rome. L’évêque de la capitale détenait alors de fait une autorité exceptionnelle. Le 3ème Canon du Concile de 381 affirma que cet « évêque doit avoir un honneur privilégié après l’évêque de Rome, parce que cette ville est une nouvelle Rome ». Autorité morale sans limites géographiques, de même qu’il n’y en avait pas à celle de l’ancienne Rome. Constantinople n’était-elle pas, comme l’écrivait saint Grégoire de Nazianze, qui vint y prêcher contre les ariens le mystère trinitaire et fut un moment son archevêque, « la première ville après la première de toutes » ?
Le concile de Calcédoine, en 453, précise le parallélisme des structures impériales et de celles de l’Eglise. Il pose les fondements du grand édifice byzantin, « symphonie de l’Etat et de l’Eglise, celle-ci représentée par ce qu’on appellera plus tard la « Pentarchie », l’accord des cinq grands patriarcats (Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem) considérés comme les cinq sens de l’Eglise. Les « privilèges d’honneur » de Constantinople sont transformés en droit d’appel (canons 9 et 17). Le 28ème canon reprend la définition de 382 : « La ville honorée par la présence de l’empereur et du sénat jouissant de prérogatives égales à celle de l’ancienne Rome impériale, doit être magnifiée dans les affaires ecclésiastiques, tenant le deuxième rang après elle ». Mais, cette fois, le ressort propre du futur patriarcat est clairement précisé : il englobe les métropoles du nord-ouest de l’Asie Mineure et Sud-Est des Balkans, dont les métropolites « seront ordonnés » par l’archevêque de Constantinople ; il en sera de même pour « les évêques qui se trouvent dans les régions barbares rattachés à ces diocèses ».
Rome refusa d’abord de reconnaître ce 28ème canon, en donnant une interprétation restrictive aux décisions de Nicée qui n’attribuaient de « privilèges d’honneur » qu’aux trois sièges de Rome, Alexandrie et Antioche, trois fondations « pétriniennes » disait le Pape saint Léon. Celui-ci estimait aussi qu’on ne pouvait remplacer le critère « apostolique » par un critère « politique ». C’était d’ailleurs oublier que, pour les orientaux, la capitale de l’empire n’était pas d’abord un centre politique, mais bien sacral, une image de la Jérusalem nouvelle : « Je t’ai vaincu, Salomon », dira au siècle suivant l’empereur Justinien en entrant dans Sainte-Sophie. De même l’empereur récapitulait en quelque sorte le « sacerdoce royal » du laïcat. Du reste, peu à peu, Constantinople répondra à l’argument romain par le rappel de l’apostolicité de Byzance…
Devant l’opposition du Pape, le 28ème canon fut omis des listes canoniques immédiatement postérieures au concile. Mais la situation qu’il consacrait subsista. Et il parut dans le Syntagma, au 6ème siècle,puis dans les collections byzantines plus tardives ; et on le trouve dès ce même 6ème siècle, dans la plus ancienne collection canonique latine, la Prisca.
A la fin du 6ème siècle, l’Empire « œcuménique » ayant disparu en Occident mais subsistant en Orient, le patriarche de Constantinople prit le nom de « patriarche œcuménique ». On ne saurait évoquer ici le rôle immense des patriarches de ce siège en « symphonie » souvent fort difficile avec les empereurs, mais le caractère « bipolaire » du système étant toujours rétabli par les moines, parmi lesquels se recrutent les patriarches. Nommons au moins Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, Flavien, Taraise, Photius, et les grands patriarches « hésychastes » du 14ème siècle, surtout Athanase 1er. Rappelons aussi les conciles œcuméniques réunis à Constantinople ou dans sa banlieue, le 2ème en 381, le 4ème en 451, le 5ème en 553, le 6ème en 680 ; ainsi que le seul concile d’union avec Rome jusqu’ici réussi, celui de 880, et les conciles palamites du 14ème siècle.
Lorsque l’empire, vers la fin du Moyen-Age, se rétrécit jusqu’à ne plus englober que la banlieue européenne de sa capitale et une partie du Péloponnèse, le Patriarcat se prépare à lui survivre et administre de vastes territoires contrôlés par l’Islam ou appartenant au royaume de Pologne-Lituanie (et jusqu’en 1448, à la principauté de Moscou). Le patriarche Philotée, en 1354, écrit que l’Eglise de Constantinople « manifeste à toutes les saintes Eglises de l’univers sa sollicitude et son attention ». Au grand-duc Dimitri de Moscou, il se présente en 1370 comme « le père commun des chrétiens ». Et dans les actes patriarcaux du 14ème siècle, Constantinople est présentée comme le témoin majeur de la vraie foi.
L’ethnarque
La disparition de l’Empire byzantin créa un vide historique et juridique, puisque c’est l’empereur, par exemple, qui convoquait les conciles. Ce vide fut comblé par le Patriarche de Constantinople, grâce au rôle d' »ethnarque » responsable du millet orthodoxe, que le Sultan lui accorda. « Ethnarque » c’est à dire chef de la « nation » chrétienne, au sens musulman pour lequel le civil et le religieux sont inséparables. Certes Moscou s’est proclamé autocéphale en 1448, en prenant prétexte de la « trahison » de la foi par Constantinople au concile d’union de Florence. Mais l’extension vers l’est de la Pologne-Lituanie permet au Patriarcat d’y reconstituer, sous sa dépendance, la métropole ukrainienne de Kiev (jusqu’à l’absorption de l’Ukraine par la Moscovie à la fin du 17ème siècle).
Dans ce nouveau contexte, la primauté de Constantinople fonctionne utilement jusqu’au 19ème siècle. Le Patriarcat réunit assez régulièrement, chaque fois qu’un problème grave se pose, les patriarches orientaux et leurs synodes, et souvent de nombreux évêques. Seul cet accord du primat et de ce qui reste de la Pentarchie permet alors l’élévation d’une Eglise à la dignité patriarcale. Pour la Russie en particulier, cette élévation, réalisée en 1589 par le patriarche Jérémie II, fut confirmée par les conciles de Constantinople en 1590 et 1593. L’Eglise russe admise au cinquième rang dans une Pentarchie momentanément complétée, fut toujours consultée, même après l’introduction, en 1721, du système synodal. En 1848 par exemple, Constantinople eut soin de se mettre d’accord avec le Saint Synode russe au moment d’élaborer l’encyclique conciliaire sur le problème de l’infaillibilité.
Ainsi ont été réunis à Constantinople les conciles de 1454 et 1484 (pour rejeter l’union de Florence), de 1590 (pour instaurer le patriarcat russe), de 1638 (pour préciser la position orthodoxe entre Réforme et Contre-Réforme), de 1663 (sur les troubles dans l’Eglise russe), de 1735 (pour résister à l’offensive uniate et au re-baptême des orthodoxes imposée par Rome après des siècles de communicatio in sacris sporadique), de 1848 et 1872 (sur de difficiles problèmes ecclésiologiques). L’érection du Patriarcat de Moscou et l’arbitrage rendu dans la crise de l’Eglise russe au 17ème siècle ont permis de préciser la primauté de Constantinople dans des termes qui montrent que dans une Eglise « déchirée », Constantinople entend assurer comme l’intérim de la Rome du premier millénaire : Question : Tout jugement des autres Eglises peut-il être porté en appel devant le trône de Constantinople et celui-ci peut-il résoudre toute affaire ecclésiastique ? Réponse : Ce privilège était celui du pape avant que l’Eglise n’ait été déchirée par les présomptions et la malveillance. Mais l’Eglise étant désormais déchirée, toutes les affaires des Eglises sont portées devant le trône de Constantinople, lequel prononce la sentence car, d’après les canons, il a le même primat que l’ancienne Rome. (Tome patriarcal et synodal de 1663). Le combat contre le nationalisme religieux.
Au 19ème siècle, le recul de l’empire ottoman et la poussée du mouvement des nationalités amènent donc la multiplication des Etats nationaux dans l’Europe du sud-est. Chaque nation revendique et établit d’autorité -sauf la Serbie qui obtint au préalable l’assentiment de Constantinople- son indépendance ecclésiastique. La politique et le nationalisme inversent l’échelle traditionnelle des valeurs : la nation n’est plus protégée et défendue par l’Eglise, c’est l’Eglise qui devient une dimension de la nation, un signe d’appartenance nationale, et qui donc doit servir l’Etat. Ainsi l’autocéphalie traditionnelle tend à se transformer en autocphalisme à la fois absolu et homogène. Non plus interdépendance mais indépendance. Calquant le fonctionnement de l’administration ecclésiastique sur celui du pouvoir d’état. Et les évêques devenant de quasi-fonctionnaires.
L’autocéphalisme se théorise peu à peu, il affirme que le fondement de l’ecclésiologie n’est pas le principe eucharistique, mais le principe ethnique et national. L’Eglise « locale » signifie désormais l’Eglise « nationale », avec application absurde de l’analogie trinitaire, la « primauté d’honneur » devenant « l’égalité d’honneur ».
Le dernier concile de la Pentarchie se tint en 1872 à Constantinople et condamna avec beaucoup de fermeté le phylétisme, c’est-à-dire le nationalisme ecclésiastique (l’Eglise bulgare, qui venait de proclamer son autocéphalie sans l’accord de Constantinople, exigeait l’établissement à Constantinople même, pour la minorité bulgare, d’un évêché ne dépendant que d’elle et donc entièrement soustrait à la juridiction de l’évêque local).
« Le phylétisme, c’est-à-dire la distinction fondée sur la différence d’origine ethnique et de langue, et la revendication ou l’exercice de droits exclusifs de la part d’individus et de groupes de même pays et de même sang, peut avoir quelque fondement dans les états séculiers, mais il est étranger à notre propre ordre… Dans l’Eglise chrétienne, qui est une communion spirituelle destinée par son chef et son fondateur à com- prendre toutes les nations dans l’unique fraternité du Christ, le phylétisme est quelque chose d’étranger et de totalement incompréhensible. La formation, dans un même lieu, d’églises particulières fondées sur la race, ne recevant que les fidèles d’une même ethnie,… et dirigés par les seuls pasteurs de même race, comme le veulent les adeptes du phylétisme, est un événement sans précédent… »… Chaque Eglise ethnique cherchant ce qui lui est propre, le dogme de l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique » reçoit un coup mortel. Si les choses sont ainsi – or elles le sont – le phylétisme se trouve en contradiction manifeste avec l’esprit et l’enseignement du Christ, et s’y oppose… »
Une situation radicalement nouvelle
Dès le début du 2Oème siècle, Constantinople comprend qu’une nouvelle organisation s’impose où les Eglises nationales, qu’elle reconnaît ou va reconnaître peu à peu, seraient pleinement présentes dans une unité restaurée. La condamnation de 1872 étant restée sans effet, le Patriarcat Œcuménique admet la fin de la Pentarchie. En 1902, le patriarche Joachim III propose aux Eglises orthodoxes de se consulter tous les deux ans. En vain.
Mais les événements politiques vont changer d’une manière bien plus radicale la situation du Patriarcat. Les guerres balkaniques de 1912-1913, la première guerre mondiale, le départ des chrétiens d’Asie mineure, la fin de l’Empire ottoman et l’émergence d’une nation turque, non seulement réduisent à l’extrême le ressort direct du Patriarcat mais transforment entièrement sa situation. Fini le système du millet orthodoxe. Le traité de Lausanne, en 1923, définit et garantit le Patriarcat comme un établissement religieux demeurant à Constantinople et s’occupant des affaires purement spirituelles de la minorité de nationalité turque et « de religion grecque-orthodoxe ». Le tezkeré (arrêté) de la préfecture de Constantinople du 6 décembre de la même année stipule que « lors des élections spirituelles et religieuses qui auront lieu en Turquie, les électeurs seront des ressortissants turcs et exerceront des charges spirituelles à l’intérieur de la Turquie lors de l’élection, et que la personne qui sera élue aura les mêmes qualifications ». Ainsi les laïcs, qui participaient nombreux à l’élection du patriarche, en sont désormais exclus, ainsi que les métropolites et évêques résidant hors de la Turquie. Du statut antérieur reste seulement une clause restrictive, le droit pour le gouvernement, lorsque se prépare une élection patriarcale, de radier qui il veut de la liste des éligibles.
L' »échange des populations », prévu en 1923, amorça l’exil d’une grande partie de la population grecque-orthodoxe, et ces départs devinrent massifs avec la crise chypriote, dans les années 50 et 60. Le ressort direct du Patriarcat est donc réduit aujourd’hui, outre les petites communautés qui subsistent en Turquie (à Istanbul, et dans les îles d’Imbros et de Ténédos), à l’Athos, Patmos, les îles du Dodécanèse, la Crète (semi-autonome), la Diaspora grecque partout dans le monde -elle est particulièrement importante et influente aux Etats-Unis, et des fractions de la Diaspora russe et ukrainienne : notamment en France et en Europe occidentale, l’Archevêché d’origine russe, aujourd’hui de facto multinational, dont le siège est à Paris. Il avait obtenu la protection de Constantinople lors du plus extrême asservissement du Patriarcat de Moscou. L’Eglise orthodoxe de Finlande est une Eglise autonome qui dépend du Patriarcat. Les éparchies des « Nouveaux Territoires », c’est-à-dire des régions de Thrace et de Macédoine annexées par la Grèce en 1912-1913, continuent de dépendre de Constantinople mais leur tutelle a été confiée à l’Eglise de Grèce.
L’école de théologie du Patriarcat, dans la petite île de Halki, en Mer de Marmara, a été fermée en 1971 par le gouvernement turc. Le Patriarcat s’est doté depuis de plusieurs écoles ou centres d’études, mais hors de Turquie, ce qui pose quelques problèmes : l’Institut patriarcal d’études patristique, à Thessalonique ; le Centre orthodoxe du Patriarcat Œcuménique à Chambésy, près de Genève ; le monastère patriarcal de Ste Anastasie Pharmakolyutria en Chalcidique ; et l’Académie orthodoxe de Crète. Le renouveau de l’ecclésiologie orthodoxe.
Le renouveau de l’ecclésiologie orthodoxe au 20ème siècle, d’abord dans la Diaspora d’origine russe, avec Nicolas Afanassieff et Jean Meyendorff, ensuite dans la théoogie grecque avec Nikos Nissiotis et Jean Zizioulas, a permis une nouvelle interprétation de la primauté. On peut résumer ainsi son acquis : — L’Eglise est une communauté eucharistique en communion avec toutes les autres, communion qui s’organise autour de « centres d’accord ». Cette conciliarité permanente des Eglises s’exprime dans des phéno- mènes de « réception ». Certaines Eglises disposent d’une autorité morale plus considérable, et donc d’une capacité de « réception » plus prestigieuse. Ce sont soit des siècles fondés par les apôtres, soit des villes dont le rôle politique et culturel, voire symbolique, est, ou a été, plus marquant. Ces « centres d’accord », dans l’Eglise ancienne, ont constitué une vivante et complexe hiérarchie, allant de la région à l’Eglise universelle par la nation et l’ère de civilisation. L’autocéphalie se situe dans ce jeu d’interdépendances multiples. L’Eglise nationale n’est donc qu’une forme contingente qui, loin de se durcir en autocéphalisme absolu, devrait être relativisée. — La primauté ou « priorité » universelle est donc fondamentalement service de la communion des Eglises. Primauté d’honneur, si l’on veut, à condition de préciser que l’honneur implique responsabilité et prérogatives réelles. Dans l’Eglise orthodoxe, la primauté revient à l’Eglise de Constantinople, de par les dispositions canoniques et une longue expérience historique. Lorsque l’unité de foi sera rétablie, elle reviendra à nouveau à l’Eglise de Rome, selon le modèle, mais pleinement élucidé désormais, du premier millénaire.
Avec les théologiens byzantins et les innombrables témoignages orientaux du premier millénaire, on doit admettre un ministère pétrinien dans l’Eglise universelle, par analogie entre la fonction du primat parmi les évêques et celle de Pierre parmi les apôtres. A condition de souligner l’interdépendance du primat et de tous les évêques et aussi l’importance du sensus ecclesiae du peuple de Dieu, animé par les « hommes apostoliques », startsi ou gerontes, au charisme strictement personnel, ce que Paul Evdokimov nommait la dimension « johannique » de l’Eglise.
En 1978, bien qu’il fût en désaccord avec le Patriarcat Œcuménique au sujet de l’autocéphalie américaine (attribuée unilatéralement par Moscou, en 1970, à la fraction d’origine russe et subcarpathique des orthodoxes des Etats-Unis), le P. Jean Meyendorff écrivait, d’un point de vue surtout pragmatique, dans un article intitulé : Needed ; the ecumenical Patriarcate ( On a besoin du patriarcat Œcuménique ; The Orthodox Church, vol. 14, n° 4, p. 4 s.) : « Il est incontestable que la conception orthodoxe de l’Eglise reconnaît la nécessité d’un leadership sur l’épiscopat universel, d’une certaine autorité de porte-parole de la part du premier Patriarche, d’un ministère de coordination sans lequel la conciliarité est impossible. Du fait que Constantinople, nommée aussi « Nouvelle Rome », était la capitale de l’Empire, un concile Œcuménique a désigné son évêque -selon les réalités pratiques de l’époque- pour cette position de leadership qu’il a gardée jusqu’à aujourd’hui , même si l’Empire n’existe plus. Et le Patriarcat de Constantinople n’a pas été dépourvu d’œcuménicité, étant toujours en relation avec la conscience conciliaire de l’Eglise. Dans les années chaotiques que nous traversons, l’Eglise orthodoxe doit certainement utiliser le leadership sage, objectif et faisant autorité du Patriarcat Œcuménique ».
Vers une définition nouvelle de la primauté.
Ce grand labeur théologique a convergé avec l’attitude prophétique du Patriarche Athénagoras Ier qui, depuis 1953, s’est voué au rassemblement de l’orthodoxie. Effort fidèlement continué par ses succes- seurs Dimitrios Ier et Bartholomée Ier. Je vais tenter de montrer comment la primauté de Constantinople a essayé de se redéfinir, en utilisant les déclarations de ces patriarches, et finalement en donnant la parole à Bartholomée Ier. J’utiliserai aussi l’ouvrage du Métropolite Maxime de Sardes : Le Patriarcat Œcuménique dans l’Eglise orthodoxe et le recueil Eglise locale et Eglise universelle publié par le Centre du Patriarcat Œcuménique à Chambésy.
La primauté n’est pas un honneur vide, elle n’est pas non plus une papauté orientale. La faiblesse matérielle de Constantinople, sa pauvreté assurent d’ailleurs de son désintéressement et, paradoxalement, accroissent son prestige. Le Patriarche Œcuménique n’a pas la prétention d’être un « évêque universel ». Il ne revendique aucune infaillibilité dogmatique, aucune juridiction immédiate sur tous les fidèles. Il ne dispose d’aucun pouvoir temporel. Centre d’intercession pour la garde de la foi et l’union de tous, sa primauté n’est pas un pouvoir mais une offrande comme sacrificielle de service, dans l’imitation de Celui qui est venu non pour être servi mais pour servir. Il est prêt, au sein d’une collégialité fraternelle, à se mettre à la disposition des Eglises-sœurs, pour que s’affermisse leur unité et que se réalise la mission de l’orthodoxie. Son service est d’initiative, de coordination et de présidence, toujours avec l’accord des Eglises-sœurs. Tout en étant une abnégation créatrice toujours à renouveler et, pourrait-on dire, à mériter, la primauté relève des structures de l’Eglise, elle est indispensable pour assurer l’unité et l’universalité de l’orthodoxie. Elle met en relation les Eglises-sœurs, les amène à travailler et à témoigner ensemble, met en mouvement leur co-responsabilité. Depuis la disparition de l’Empire, elle assume le rôle d’ Eglise « convoquante ». Après avoir consulté et obtenu l’accord des Eglises-sœurs, elle peut se faire leur porte-parole. Elle est enfin un recours pour les communautés en situation exceptionnelle et dangereuse.
Deux présupposés sont impliqués par ce service : d’une part la sauvegarde du principe de conciliarité, de l’autre le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres Eglises.
Athénagoras Ier (19488-1972) mit le premier en application cette conception de la primauté. A partir de 1961, il réussit à convoquer une série de conférences pan-orthodoxes où éclata, à l’étonnement de beaucoup, le « miracle de l’unité ». Il dota le Patriarcat d’une antenne à Chambéry, près de Genève, où il installa un secrétariat préconciliaire. Ses deux successeurs sont allés rendre visite à toutes les Eglises ortho- doxes, ils ont réuni plusieurs conférences préconciliaires, ainsi qu’une « synaxe » e tous les primats orthodoxes en 1992, à Constantinople même, et en 1995, à Patmos. Et l’irritant problème de la Diaspora a trouvé, de 1993 à 1995, grâce à ce travail pré-conciliaire, le commencement d’une solution : l’organisation d’ « assemblées d’évêques », pays par pays. Sainteté, comment vous apparaît votre rôle de Patriarche Œcuménique ?
Le Patriarche Œcuménique a pour mission de veiller au caractère universel de l’orthodoxie, de manifester son unité et de donner, quand il le faut, l’impulsion nécessaire dans ce sens. Pour reprendre l’expression de saint Ignace d’Antioche, le primat doit « présider dans l’amour », ou plutôt « à l’amour ». C’est pourquoi j’ai inlassablement visité, consulté toutes les Eglises orthodoxes, j’ai réuni et souhaite réunir à nouveau leurs primats. L patriarche de Constantinople est le primus inter pares dans l’épiscopat de notre Eglise. Il est responsable de la coordination des Eglises-sœurs. Dans le grand recueil de droit canonique de langue grecque, le Pidalion -un mot qui signifie « gouvernail »- on trouve cette définition : « Le propre du Patriarche est d’avoir charge d’enseignement et, sans se troubler, de se considérer comme l’égal de tous, grands et petits ». L’égal, ou plutôt le serviteur. Et ce ne doit pas être une figure de rhétorique, comme tant de formules le sont devenues dans le christianisme ! Je l’ai dit dans mon homélie à St-Pierre de Rome, les pasteurs doivent vivre dans l’humilité et se repentir de la tentation du pouvoir, parce que, comme l’a dit le Christ, « cette espèce de démons ne peut être chassée que par la prière et le jeûne ». La primauté est un ministère de service, un ministère crucifiant, il ne faut pas souhaiter être admiré des hommes, mais plaire à Dieu. Si les mots n’engagent pas la vie, ils deviennent un verbiage qui disqualifie l’Evangile. L’orthodoxie doit être une « orthopraxie », sinon elle se réduit à un pharisaïsme orgueilleux. Si nous comprenons un peu ce que nous disent les moines, cette capacité de se mettre radicalement en cause, nous découvrons que les péchés, les erreurs, les souffrances du frère pèsent sur moi, et que chacun est responsable pour tous. C’est bien cela ma charge, au double sens de devoir et de fardeau : être responsable pour mon frère. Car on ne se sauve pas seul : on se sauve avec toute l’humanité et tout l’univers. Le Christ a dit à son Père, en parlant de ses disciples : « Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie, et je me consacre moi-même pour qu’ils soient aussi sanctifiés en vérité » (Jean 17, 18-19). Oui, il a dit cela, le Seigneur sans péché ! Combien plus devons-nous, nous pécheurs, nous purifier et nous consacrer nous-mêmes dans notre humble service. Dans l’épître aux Ephésiens, nous lisons que le Christ « ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, mais s’anéantit lui-même… » (2, 6). Ekènosen – s’évida en quelque sorte. C’est ce que les théologiens nomment la « kénose ». Quand il se révèle, notre Dieu n’apparaît pas comme une plénitude close, qui nous écraserait, mais comme une ouverture d’amour où l’autre, l’homme, trouve sa vocation et sa liberté. Ainsi, nous qui sommes à l’image du Christ, sommes-nous appelés à nous comporter, pour que l’autre soit sauvé, pour que l’autre soit. La primauté n’est donc pas un pouvoir mais une « kénose » qui se veut -se prie- vivifiante pour les autres. Mon prédécesseur, le doux Patriarche Dimitrios, incarna vraiment l’humilité du Christ, cette humilité que doit revêtir l’Eglise si elle veut être parmi les hommes. Ce qu’elle est dans son essence eucharistique : la communauté des anawim, des pauvres du Christ. C’est pourquoi je tente de me consacrer au Seigneur, à son Autel. A son service et au service de l’humanité qui est sienne. Pour être crucifié dans l’Eglise crucifiée, pour être ressuscité avec tous dans l’Eglise ressuscitée. La Croix et la Gloire s’identifient, comme l’a montré Saint Jean, le Vendredi saint et Pâques sont inséparables. Je me réfugie dans la miséricorde de Dieu, en priant qu’il manifeste sa force dans ma faiblesse. « Les rois des nations, dit Jésus, dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, qu’il n’en soit pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ! » (Luc 22, 24-27).
Le primat doit mériter sans cesse une autorité qui n’est pas un pouvoir mais la capacité, au sens premier de ce mot qui vient du verbe augere, faire croître, de se soumettre à toute vie pour la faire grandir toute. Le patriarche œcuménique agit toujours en communion, puisque c’est la communion qu’il doit favoriser. Il ne peut rien sans l’accord de l’ensemble des Eglises, il tient pour irremplaçable la valeur de la conciliarité à travers laquelle le Saint Esprit parle à l’Eglise.
Ce rayonnement de la communion n’a pas de limites. Le patriarche doit être un « veilleur œcuménique » qui prie et travaille sans se décourager pour l’unité des chrétiens. Au-delà, il témoigne et lutte pour la paix entre tous les hommes, de toutes les cultures, de toutes les religions.
Car nous appartenons à une seule famille humaine qui a le même Père céleste. Car le Christ porte en lui toute l’humanité. Rappelez-vous la parabole du Jugement dernier, dans l’évangile selon Saint Matthieu : les « bénis du Père » sont appelés par leur « Roi » symbolique, parce que, dit-il « j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir ». Et comme ils ne savent pas, de le connaissent pas, s’étonnent, il explique : « en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25, 34-40).
Le Patriarcat se trouve en Turquie. Je suis personnellement un citoyen loyal de ce pays qui est le mien et qui m’est cher. C’est une nation moderne et laïque où coexistent juifs et chrétiens de toutes confessions, avec une majorité de musulmans. La minorité grecque orthodoxe se compose de citoyens bien insérés dans l’Etat démocratique turc. Du reste l’hospitalité turque, traditionnellement, est généreuse. Dans la demeure patriarcale, une mosaïque représente Mehmet II, le Conquérant, concluant avec le patriarche Gennadios Scholarios une alliance qui devait préserver les droits religieux des orthodoxes. Le Patriarcat est une Institution de nature purement spirituelle. En Turquie même, son utilité est incontestable pour promou- voir des valeurs spirituelles et morales qui sont communes aux chrétiens et aux musulmans. Il ne se mêle jamais de politique. Ce qui ne l’empêche pas, bien au contraire, de participer à la douleur des personnes et des peuples qui sont victimes de l’histoire.
Et le patriarcat lui-même est une victime de l’histoire. Il subit les conséquences des mauvaises relations entre deux Etats, la Grèce et la Turquie. Deux Etats qui, pourtant, sont condamnés à vivre ensemble. Deux Etats dont les peuples se ressemblent, marqués qu’ils sont par le même creuset de la Méditerranée orientale. Certains mots grecs sont passés dans la langue turque et inversement. Les coupoles des grandes mosquées d’Istanbul sont imitées de celles de Sainte Sophie. En musique, ce sont souvent les mêmes mélismes. Sans parler de la cuisine ! Cette convivialité a été en partie détruite par la crise de Chypre. Nous avons alors servi d’otages. Elle est menacée maintenant par le drame bosniaque et les querelles concernant la mer Egée. La communauté grecque-orthodoxe d’Istanbul a ainsi subi une terrible hémorragie. Il y a cinquante ans, nous étions plus de cent mille, aujourd’hui nous ne dépassons pas les cinq mille. Et l’école théologique de Halki reste fermée. Qui nous succédera, qui gardera en vie le patriarcat ? La montée de l’islamisme inquiète tous les démocrates de ce pays. En 1993, le cimetière orthodoxe de Néochorion, comme d’autres cimetières, a été profané. Comble de l’ironie : la presse turque me prête des sympathies pour la Grèce, la presse grecque pour la Turquie. Pourtant, je n’ai d’autre souci que la réconciliation et la paix…
Partir d’ici ? C’est exclu. Le patriarcat n’a jamais quitté cette ville, sauf pendant cinquante-sept ans, au 13eme siècle, quand elle fut occupée par les latins, et qu’il s’est réfugié à Nicée. Aujourd’hui, s’installer à Thessalonique ou à Patmos, se serait s’identifier à la Grèce, alors que le patriarcat se situe au-dessus des nations. De ce point de vue, je considère comme une bénédiction de siéger dans un pays de constitution laïque et à majorité musulmane. Istanbul est à la croisée des routes du monde, un pont entre l’Europe et l’Asie, l’Occident et l’Orient, le christianisme et l’islam. Et nous, au patriarcat, nous nous considérons nous-mêmes comme un pont entre les peuples, nous refusons les murs qui divisent. Certes, nous ne pouvons cacher ni notre pauvreté, ni une certaine précarité. L’une et l’autre me semblent en accord avec l’esprit de l’évangile. C’est une erreur de penser qu’un témoignage spirituel a besoin de la richesse et de la puissance. Voyez les moines : plus ils sont pauvres, plus ils jeûnent, non seulement de nourriture, mais de nos illusions et de nos folies, plus ils font place à la force de l’Esprit et rayonnent dans l’invisible, mais aussi dans le visible, sur la face cachée de l’histoire.