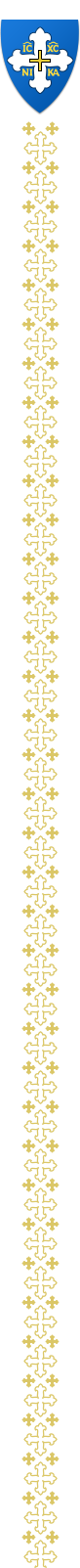DE L’ASCESE
Le mot « ascèse » n’existe pas dans le Nouveau Testament. Nulle part, il n’est mentionné. Il est devenu monnaie courante par la suite, dans la littérature patristique, avec la mouvance de ces hommes qui vivaient loin du monde, les moines. Mais dire de ce mot qu’il n’existe pas textuellement n’est pas sous-entendre que la réalité qu’il désigne ait été absente de l’expérience quotidienne de cette communauté humaine qui s’était tissée primitivement dans l’attente du Ressuscité. L’ascèse, bien comprise, serait plutôt une conséquence et un fruit mûr tombé de cet arbre de la Bonne Nouvelle qui fut planté sur le Golgotha.
FONDEMENT DE L’ASCESE
Le fondement initial de l’ascèse est que le spirituel prime sur le matériel, celui-ci englobant celui-là. Ce n’est pas le matériel qui recèle une part de spirituel, comme une sorte de clairière vierge inaccessible aux regards indiscrets, mais plutôt le spirituel qui, bien que transcendant, s’exprime au sein du matériel et même jusqu’au creuset du charnel, en ceci que le Christ dit de la courtisane qu’elle a beaucoup aimé (Lc 17, 47).
William Blake, peintre et poète à ses heures, avouait, gravant ainsi les tables du renversement radical qu’opère la perspective spirituelle, perspective qui, ne l’oublions pas, est toujours inversée : « L’homme n’a pas un corps distinct de son âme, car ce qu’on appelle corps est une partie de son âme perçue par les cinq sens, principales entrées de l’âme dans cette période de vie » (W. Blake, Le mariage du Ciel et de l’Enfer, José Corti, 1994).
ECLAIRCISSEMENT SUR L’ECHELLE DES VALEURS
Nous avons tous, à des degrés divers, une échelle de valeurs, en toile de fond à notre champ de conscience, qui nous donne la possibilité de lire et, par là, d’interpréter le monde. Bien souvent, elle n’est visible qu’après-coup, parfois même par lapsus.
Or, cette grille normative n’accorde que bien rarement la place d’honneur aux exigences de l’esprit, à ces valeurs qui seules promettent l’excellence et la plénitude de l’existence, et cela même chez ceux qui se disent spirituels.
C’est pourquoi un des premiers et non des moindres exercices de l’ascèse est de discerner, au gré de notre quotidien, où le bât blesse. Dès lors que notre comportement n’est plus motivé par une impulsion intérieure d’ordre spirituel, il a une valeur à sa racine qui ne s’origine pas du Royaume de Dieu, mais qui provient du monde. Et c’est là que nous avons, chacun pour notre part, à œuvrer, au sein de ce commerce privé que nous sommes seuls à côtoyer.
A notre échelle, cette retraite intérieure, cet arrière-plan intime et profond, est la plupart du temps le dernier de nos soucis, occupés que nous sommes à lustrer l’extérieur de la coupe, à embellir l’enveloppe apparente de notre vie. Or, le regard de Dieu n’est pas extérieur à nous ; il procède bien de l’intérieur.
Souvent, nous dépensons tout notre être et nous épuisons dans des activités certes louables, qu’elles soient sociales, culturelles, théologiques, voire même ascétiques, sans que ces activités ne portent, spirituellement s’entend, de fruit. Peut-être qu’à ce moment précis il nous est possible de prendre conscience que nous investissons toute notre vie, et là est le talon d’Achille, dans des valeurs peut-être pas si louables que cela. Non pas que ces valeurs ne soient pas approuvables, en tant que telles, mais parce qu’elles obstruent la libre effusion de l’Esprit, en esquissant toute une idéologie latente et un ensemble de principes finalement formalistes dont notre vie intérieure dépend. L’ascèse relève ici du discernement de ce qui enlise le désir de Dieu.
CE QUE L’ASCESE N’EST PAS
Etrangement, il faut commencer, à un moment ou un autre, par dire de l’ascèse ce qu’elle n’est pas, car elle demeure un phénomène quelque peu mal compris, jusque parfois dans des milieux religieux. Qu’on l’interprète soit comme une militarisation, soit comme une négation de la personnalité ou, à l’extrême, comme une flagellation, plus proche du roman d’Umberto Eco adapté en film, « Au nom de la rose », que de la réalité, on est toujours assez loin du compte. Ces images, à l’eau de rose, sont curieusement, à l’heure actuelle, fort présentes dans bien des subconscients.
Penser de l’ascèse qu’elle est le fruit d’une morbidité pathologique, c’est aller un peu vite en besogne et sans nul doute cacher une tristesse malsaine dans les nombreux replis de son âme. Pour bien comprendre l’ascèse, ne faudrait-il pas se départir, en plus de toutes les idées reçues déjà plus ou moins élaborées de la « culture » ambiante, de toute une complaisance dans la souffrance, sinon de relents manichéens qui survivent à l’ombre du christianisme, et être honnête avec soi-même ?
ASCESE DE LA LIBERTE
D’abord, entendons-nous bien sur ce que l’on comprend par ce mot de liberté inlassablement prêché à l’heure actuelle, mais toujours très mal compris, car taxer l’ascèse de formalisme, d’étranglement de la personnalité ou de pression des religieux pour nous maintenir en esclavage, c’est toujours la supposer faire de l’ombre à la liberté. Mais ce qui ne va pas serait plutôt, selon nous, cette vision de la liberté qui sous-tend un tel raisonnement, somme toute assez simpliste. Qu’est-ce à dire ? Ascèse et liberté seraient-elles incompatibles ?
Dans notre société déstructurée, consommatrice et hypermédiatisée, on a une conception dévitalisée, invertébrée, de la liberté. Être libre, c’est grosso modo être passif devant le cours de sa vie. Satisfaire ses instincts serait ainsi la quintessence de la liberté, le maximum de ce dont l’homme serait capable. Le bonheur, dans cette optique, serait s’abandonner à de simples sensations, aussi agréables qu’évanescentes et brèves. « Je suis libre quand je fais ce que je veux », dit le credo d’une certaine mentalité de notre époque.
Tout cela est très bien, assurément, seulement on oublie qu’il existe une manière créatrice et active d’être libre. On ne saisit pas qu’être libre, c’est agir selon tout le poids et la force de sa conscience, lourde parfois de souvenirs de plus de mille ans, comme l’affirmait Baudelaire, et non à partir de la légèreté de ces pseudo-idées en vogue qui in fine tournent avec le vent. Là, il convient de comprendre qu’être libre, c’est penser par soi-même et non « être pensé » par des rêveries tirées tout droit du dernier long métrage que l’on a vu. Bref : être libre, c’est cesser, autant que faire se peut, de subir sa vie.
La liberté n’est envisageable, en tout et pour tout, que comme une conscience et une présence à soi, une intuition de sa propre incognoscibilité, à l’image de Dieu. Un des obstacles, en effet, parmi les plus pernicieux que rencontre la liberté est d’être plus que tonvaincu de se connaître parfaitement, « sur le bout des doigts » dit-on, car alors on risque de s’enferrer dans un personnage que l’on jouera sur la scène de ce que Shakespeare appelle « le théâtre du monde » : jeu de masques tragique qui peut durer toute une vie. « Il y a quelque chose de pire, disait Charles Péguy, que d’avoir une mauvaise pensée. C’est d’avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C’est d’avoir une âme toute faite » (C. Péguy, Notre conjointe, Gallimard).
Du reste, cette liberté fait peur parce que l’on ne veut pas fondamentalement être libre. Ce que l’on confond avec des exigences, que l’on imagine intolérable, nous angoisse. « Nous ne pouvons supporter ni nos vices ni leurs remèdes », avouait, avec beaucoup de philosophie, Tite-Live.
On préfere un système de préjugés bien confortable, où l’on se sent à l’aise si possible sinon tant pis, à une conscience et mutatis mutandis à une existence bien enracinée dans la terre de la réalité. L’homme a toujours préféré l’esclavage à la liberté, déclare souvent Nicolas Berdiaev dans ses écrits, parce que tous les asservissements, extérieurs et intérieurs, avec lesquels il se confond n’exigent, tout compte fait, aucune mort réelle à soi. Qu’on ne s’y trompe pas : la liberté n’est pas de faire ce que l’on veut, mais elle est la possibilité spirituelle qu’a l’homme de se dépouiller. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » (Mt 5, 3).
On s’évertue à ne pas admettre que la liberté, et non cette indépendance finalement esclave d’elle-même, relève déjà de la dynamique de l’ascèse.
CONNAISSANCE OU DECOUVERTE DE SOI ?
A ce stade, peut-être pouvons-nous pressentir que l’ascèse, c’est-à-dire le frein que l’on pose au ressac permanent qu’est notre monde intérieur, est nécessaire à qui veut bien se retrouver soi-même. L’ascèse est alors l’instrument premier de la découverte de soi, puisqu’elle a pour effet immédiat d’unifier l’être, de clarifier ses aspirations et de ramasser sa conscience pulvérisée en cent mille soucis, sensations, souvenirs, projets ou autres. C’est alors devenir ce que l’on est, dans ses grandes profondeurs, et s’orienter vers Dieu. Le temps du Grand Carême est fondamentalement cette franchise avec soi-même, cette cohérence personnelle et intime.
Il faut ajouter et cela est très important, qu’il n’y a pas de recette miracle, de « casuistique » infaillible, en ce qui concerne l’ascèse à laquelle nous convie l’Eglise, quarante jours avant Pâque. On ne répètera jamais assez que le jeûne prescrit n’est pas un but en soi, mais simplement un moyen. Ce n’est pas une loi incontournable mais un exercice, une éducation de l’âme.
L’horizon qui nous guide est alors cette unification intérieure, cette densification de la conscience, dans l’abandon aux énergies Divines. C’est prendre conscience, de manière toujours plus aigüe, de la profondeur et de la plénitude incommensurables du mystère de l’Incarnation de Dieu dans la pâte de l’histoire.
L’Ecriture nous dit que Juda, après avoir livré le Maître, se scinda de l’intérieur puis se suicida (Act 1, 18-19 et Mt 27, 3-10). Ainsi, le péché, selon un de ses masques, serait un dédoublement de la personne, dipsychia selon l’intuition de Clément d’Alexandrie (St Clément d’Alexandrie, Homélie pascale, n°12), un déchirement intérieur, comme une volonté aphone de destruction, et finalement une non-présence consciente à Dieu. En s’oubliant soi-même, on perd ipso facto la possibilité personnelle de se placer dans le souvenir vivifiant de Dieu.
C’est pourquoi l’ascèse à laquelle tout chrétien est appelé passe par un discernement de ce qui, selon chacun, divise, disperse et désintègre la conscience personnelle.
Il y a autant d’ascèses, de portes étroites, que de consciences humaines. L’ascèse est avant tout un discernement et une libération de ce quί déchire de l’intérieur, de ce qui désagrège l’intégrité intérieure.
DEPASSEMENT DE LA SUBJECTIVITE
Ce discernement peut nous amener à penser ceci : le phénomène de l’ascèse, à travers ses nombreuses et diverses expressions historiques, s’est toujours révélé, essentiellement, comme une méthode de libération des mailles de ce filet qu’est l’individualité.
L’homme est emprisonné en lui-même, il est esclave de son propre tyran intérieur. Non pas que son corps soit un tombeau, comme certains courants philosophiques, orphiques ou même pythagoriciens, ont pu le dire dans l’Antiquité, mais il est empêtré dans les rets de sa propre subjectivité. C’est là un véritable mirage que rencontre l’introspection : nous percevons insensiblement le monde et nous-mêmes à travers le prisme déformant de notre propre individualité. Nous ne connaissons que bien rarement la fraîcheur de la réalité.
Il y a effectivement ce qu’on appelle des niveaux de réalité, mais cette zone de la réalité qui, à l’extrémité scintillante de sa fine pointe, effleure les mouvements de l’Esprit de Dieu se situe par-delà les velléités et les oppositions du psychisme humain. Ce qui explique pourquoi un contact direct avec cette dernière prend irrémédiablement l’aspect d’un ébranlement de tout l’être.
Notre naissance -notre chute personnelle ?- et notre existence nous placent dans tout un contexte, qu’il soit affectif, psychologique, moral et culturel, qui définit ce qu’on appelle couramment le « caractère », le cachet inédit de l’homme, sa particularité. Cette synthèse originale des caractéristiques qui se retrouvent, à des degrés divers, dans toute l’humanité, incarne notre « personnalité », ce qui nous différencie des autres. En tant que telle, c’est une bonne chose, voulue par Dieu. C’est, en outre, un support d’activité créatrice sans lequel rien ne nous serait possible.
Mais, la personnalité, c’est-à-dire tout ce halo, dans lequel nous nous mouvons, pétri de notre histoire, de notre psychologie, de nos blessures, de nos aspirations, de nos fautes et de nos faiblesses, est aussi frappée du sceau de la nécessίté. Je ne puis être différent de ce que je suis, ni penser ou ressentir autrement que ce que je suis.
Il y a bien un niveau où nous n’avons pas le choix. Toute ce qui fait la noblesse de notre nature et de notre personnalité, si forte soit-elle, est aussi une nécessίté à laquelle nous sommes assignés.
Les pères du désert savaient cela depuis fort longtemps l’homme souffre de ne pouvoir sortir de lui-même. L’homme est vaste et il est étroit. Dire de la seule et vraie liberté qu’elle est intérieure, c’est bien, mais c’est parfois oublier et, par là cautionner, que l’homme peut beaucoup se faire souffrir, jusqu’à se mutiler « dans ce lieu vide de son intériorité » (Hegel, principes de la philosophie du droit §5 add. Flammarion, 1999). Une liberté qui ne serait qu’un repli de la conscience sur elle-même n’est pas, quoiqu’on en dise, une liberté digne de ce nom. En d’autres termes, tant que l’homme ne s’est pas affranchi des limites de sa propre subjectivité, tout ce qu’il peut bien entreprendre, extérieurement ou intérieurement, et si louable que cela soit, reste entaché de cette gangrène sourde qu’est la philautia.
Etymologiquernent, ce terme de phίlautίa veut dire amour de soi-même, solipsisme affectif. Bien que nous le désignions, à juste titre, par notre mot français d’égocentrisme, cette réalité que montre du doigt la phίlautίa est franchement plus étendue, puisqu’elle englobe même un amour de soi légitime. « Palais des glaces », la phίlautίa est un inextricable labyrinthe dont on peut désespérer quelquefois de trouver la désaltérante issue : où que l’on regarde, il n’y a que soi-même et nombreuses sont les fois où l’on cogne contre une image de soi, où l’on se heurte à des reflets persistants comme à un vieux personnage, fantôme d’un passé évanoui.
Tout ce qui nous renvoie une image de soi, plaisante ou non, relève de la « tendresse pour soi », selon l’expression consacrée de Gabriel Bunge. Et pour peu que l’on y prête attention, on s’apercevrait –« qui a des yeux pour voir qu’il voit »-, que presque la totalité de notre être est fondé, avec toute l’échelle de valeurs qui structure sa perception, sur cette infection de l’âme.
La philautia est une maladie qui, comme toute maladie, possède, à n’en pas douter, un remède. Elle est tout ce que nous avons appelé notre « personnalité ». Et de surcroît, elle obsède l’homme. Or, ces maîtres de vie selon l’Esprit que sont les sages peptiques de la tradition orientale, nous ont laissé l’héritage d’une double vérité qu’ils avaient expérimentée en eux-mêmes. D’abord, le fait très simple, évident même, que la conséquence de la phίlautίa est la sklérokardia : la sclérose, la sécheresse et jusqu’à l’atrophie de ce centre spirituel qu’est le cœur, ce noyau existentiel qui irrigue l’être. Ensuite, que la vraie vie, l’existence authentique, celle qui participe de la plénitude vitale et créatrice de la réalité, est au-delà de toute subjectivité. Le subjectif, le singulier, loin d’être une force, comme on pourrait le penser naïvement, est, dans la plupart des cas, un besoin maladif de compensation. Le besoin de se singulariser est, en fait, le fruit d’une carence identitaire : paradoxalement, plus on ressent ce besoin, moins on a en vérité de caractère et de personnalité véridiques.
DE L’IDENTITE
Il nous semble qu’en plus d’être une constante de la nature humaine sur laquelle doit se porter l’activité spirituelle, ce charme, voire cette obsession qu’exerce la phίlautίa est aussi le fruit d’une ignorance de ce que l’orient chrétien propose quant à l’épineuse question de l’identité de l’homme.
En occident, des scolastiques à Descartes, on n’a réfléchi sur l’identité de l’homme qu’en rassemblant les éléments épars qui la composent, si bien que la personnalité en arrivait à n’être plus qu’un catalogue de facultés. C’était, en cela, enfermer l’homme dans la nécessité de son génie, dans l’amertume de ses capacités, quand bien même seraient-elles de valeur.
La tradition théologique orientale réfléchit, en ce qui la concerne, non pas tant en terme d’identité, ce qui supposerait un centre de perception intérieur qui cóinciderait avec une vision aue l’on a de soi-même et donc avec une possibilité de s’illusionner, qu’en terme d’hypostase de l’homme. Sartre disait : « l’important n’est pas ce que l’on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce que l’on a fait de nous », rejoignant en cela le plan hypostatique sur lequel tablaient les pères de L’Eglise. L’hypostase, derrière un terme un peu obscur, est ce que nous faisons de tout cet ensemble qu’est notre personnalité, le monde dans son état actuel et nos relations avec nos semblables. C’est ce talent que le Maître nous confie à l’origine et que nous avons à cultiver inlassablement, que nous avons à déchiffrer et à défricher, ce talent que nous avons à réaliser comme l’œuvre magistrale et seule importante de notre vie (Mt 25, 14-30).
L’hypostase est le mode d’être propre à chacun, le thème de chaque homme, selon l’intuition perçante de Christos Yannaras cf. Yannaras, La liberté de la morale, Labor et fides, 1982). « En ce point est quelque chose de simple, d’infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n’a jamais réussi à le dire » (Bergson, La pensée et le mouvant, PUF, 1959, p.1347), pour rejoindre la pensée de Bergson. Là, tout dépend de la manière dont chacun assume sa nature et sa subjectivité. Tout est question de qualité d’être. Il ne s’agit pas de se demander, disait Saint-Exupéry, qui est heureux, mais quelle qualité d’homme est digne du bonheur.
L’hypostase close sur les nécessités humaines, quelles qu’elles soient, devient une subjectivité qui aura tôt fait de se tarir, en s’étouffant sous le poids des asservissements qu’elle se crée par nature, tandis que l’hypostase ouverte accomplit progressivement le mystère éternel de la personne, ce mystère de l’expression absolument personnelle du « secret inconcevable de Celui qui possède tout en soi, dans une sublime simplicité, et qui contient tout d’une même façon dans son infinité, simple au suprême degré » (Deлys l’Aréopagite, Traité des Noms divins, chap.5).
La situation est telle : l’homme est esclave de lui-même, il souffre de ne pouvoir sortir de l’étroitesse de sa subjectivité. De fait, toute subjectivité est, à la longue, exiguë. Et c’est pourquoi, « l’enfer, c’est les autres » (JP Sartre, Huis-clos, scène 5 ad finem), parce que « l’autre devient la confirmation de mon échec existentiel, de mon impuissance à dépasser ma volonté naturelle confondue avec l’autodéfense du moi biologique et psychologique » (C. Yannaras, op. cit. p.28). L’enfer, c’est parfois aussi la personnalité.
C’est ici que l’ascèse est primordiale, parce qu’elle offre la possibilité de se dégager de la glu de notre caractère, comme d’un sable mouvant où plus on bouge plus on s’enfonce, de sortir de soi-même, en décalant le centre de gravité de l’existence du plan égocentrique au plan hypostatique. La source de la sensation du monde, sensorium mundi; n’est plus une référence subjective, ni même la conscience humaine, mais la liberté et l’altérité radicales qui dessinent le mode d’être propre à chacun. L’important n’est plus de s’affranchir de ses difficultés, qu’elles soient spirituelles, psychologiques, matérielles ou familiales, mais la manière dont nous les assumons comme des éléments « naturels » de notre existence, pas plus dérangeants qu’une mouche quand on lit dans le calme. L’essentiel est ce que nous faisons de ce que nous sommes, la manière dont nous portons, telles ces cariatides antiques, la lourdeur, parfois insupportable de nous-mêmes.
L’ascèse est là, avant tout, parce que tant que notre être pense sur le mode -c’est-à-dire ressent- de la philautia, quoi que nous fassions, dans l’ordre de l’effort spirituel, jeûne, veille, ou autre, tout cela ne sera qu’un miroir où la subjectivité se nourrira de chimères sans cesse renaissantes.
C’est aussi pourquoi, il est peut-être plus important, à ce stade, de cibler notre ascèse sur la volonté propre, qui est comme l’expression principale, le corps, de la phίlautίa et sur la suspension du jugement qui est une manière d’autojustification que la volonté propre se donne à elle-même. La phίlautίa est une racine qui pousse des surgeons partout dans notre vie et l’ascèse devrait s’attacher, au cours d’un discernement de ses manifestations, propres à chacun, à déraciner cette mauvaise herbe du jardin de notre âme.
LE PECHE ORIGINEL : LE PECHE DE L’ORIGINAL ?
Après tout ce que nous avons dit, il semblerait que nous puissions arriver à une telle conclusion : l’ascèse, épurée de toute forme particulière, est une libération de la subjectivité, un dégagement de l’individualité. Elle ambitionne de participer à la plénitude de la vraie vie, par-delà « l’égophilisme » foncier de la nature humaine. Et si l’ascèse est une lutte corps à corps avec le péché, c’est dans ce contexte qu’il faudra situer cette eau trouble qu’est le péché : transcender la subjectivité.
Le péché, dans cette perspective, a son rôle, car il représente, à travers son échec-même, cette possibilité paradoxale de parvenir à une plénitude vitale plus grande, mais aussi plus réelle. Le péché est la condition sine qua non du repentir, de ce retournement complet de notre saisie du monde que l’on nomme, pour le coup, métanoïa.
Ceci dit, on voit où se fixe le péché, comme une tumeur dans l’organisme : il consiste en un échec à parvenir à goûter la vraie vie, au-delà de toute subjectivité. Maxime le confesseur, un père de l’Eglise, note, commentant les écrits de ce mystérieux Denys l’Aréopagite : « Il appelle péché, c’est-à-dire l’échec et la déchéance (…), ce qui n’atteint pas son but à cause de la privation, comme la flèche qui frappe à côté de la cible. Manquant le bien et le mouvement selon la nature, (…) nous nous portons vers l’inexistence totale, contre nature, sans raison et sans substance » (St Maxime le confesseur, commentaires sur les noms divins PG 4, 348C)
Le péché est l’échec de la sortie de soi vers la vie pleine et authentique, libérée des illusions de l’individualité, dans la communion à ses frères et à Dieu. Le péché est un mode d’existence contre l’existence, une séparation d’avec l’être, une exclusion individuelle de la vie, par un repliement et une complaisance dans ce repliement sur soi.
Le jugement de Dieu est alors inévitable. Dieu est plénitude de vie, véritable et authentique existence, « Celui qui est » (Ex 3, 14), au-delà des projections subjectives. Aussi, se couper volontairement de cette possibilité existentielle, c’est être automatiquement jugé par le fait même de l’Etre de Dieu. Le jugement de Dieu est, quelque part, une condamnation que l’on s’inflige soi-même. « L’homme est jugé par les mesures de la vie et de l’existence dont il s’exclut lui-même » (C. Yannaras, op. cit. p. 31).
A ce niveau, l’ascèse va se précisant : elle consiste à s’affronter à cette complaisance en soi-même, complaisance qui prive de la vraie vitalité. Le péché essentiel est de se complaire dans le marasme de notre intériorité, de préférer ce marasme à l’océan où soufflent les grands vents de l’Esprit. Le péché est une indulgence envers l’inexistence, c’est dissiper sa vie dans des futilités, enfanter des mirages et y croire dur comme fer.
LA MEDECINE DU PENTHOS
Les pères du désert apporteront cette réponse, aux conséquences psychosomatiques a posteriori importantes, à savoir que la guérison, dans le domaine de la vie selon l’Esprit, passe par le penthos, par ce long chemin du penthos. Et il nous semble que leur réponse est parfaitement appropriée à notre question : comment sortir de soi-même, pour aller à la rencontre de la vraie vie, au-delà de la subjectivité pourtant indispensable de notre être-même ?
Ce terme grec de « penthos » désigne notre mot français, aujourd’hui désaffecté, de « componction ». L’ascèse est un processus de componction, mais la componction n’est pas un abattement, elle est encore moins synonyme de tristesse.
Malencontreusement, la confusion entre la componction et l’acédie peut rapidement être faite, alors que la première est, selon la médecine ascétique, le remède approprié à la seconde. Être découragé, asthénique, n’est pas participer de cette dynamique du retour à une relation personnelle et libre avec Dieu qu’est le penthos. On peut parfois le croire.
C’est pourquoi, seule cette dynamique d’une relation personnelle, intime, avec le Dieu vivant, étant à son image et donc dégagée de toute subjectivité close, peut apporter une réponse claire et toujours actuelle aux problèmes que découvre l’homme.
EPILOGUE : LA PAIX DES GRANDS FONDS
C’est ici qu’il est, par moments, donné à l’homme de pénétrer dans la douce sphère de la paix. La paix est une nostalgie de l’Eden que l’on porte, Graal originel, en son cœur. Union des contraires : elle est aussi un éon eschatologique.
L’homme aspire, en ses grandes profondeurs qui parfois coïncident avec ses origines méta-psychologiques, à cette paix, à une forme d’harmonie et de stabilité tout à fait légitimes. Non pas une stabilité de circonférence, mais une stabilité de fond.
Il en va comme de l’image d’un lac, nous raconte Mgr Antoine Bloom : « Imaginez un lac tranquille sur lequel court une brise légère ; toute la surface frissonne et ne reflète ni le ciel ni la terre ; quant aux profondeurs, elles restent calmes, non atteintes par ce vent » (Mgr A. Bloom, Le sacrement de la guérison, Cerf, 2002).
Hiéromoine Elie, Monastère de la Dormition de la Mère de Dieu, La Faurie, France
Revue « Discernement, Διάκρισις » N°6, 2002