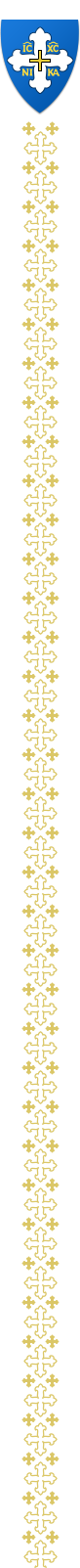Démocratie et ecclésialité
Viimati muudetud: 07.03.2015
L’être démocratique et l’être ecclésial
On s’interroge encore aujourd’hui sur le rapport entre ces deux aspects de notre vie humaine, la démocratie et l’ecclésialité (ou la démocratie et la synodalité), alors que, au cours des siècles, la question posée a été clarifiée de façon concrète et manifestement pertinente. On examinera donc cette question brièvement de trois points de vue, en partant justement du “principe de majorité” qui constitue l’élément fondamental de la condition démocratique, pour élucider l’aspect unique en son genre, celui de l’ecclésialité.
A. De l’Antiquité hellénique des Philosophes
Si nous remontons jusqu’à l’Antiquité, nous ne retrouvons pas vraiment de trace, dans la tradition hellénique antique qui se veut “démocratique”, du principe de majorité. Le monde occidental, par la suite, afin de distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, s’est fondé sur le principe d’authenticité, sur les preuves infaillibles, sur les principes de majorité et d’utilité du résultat. Pour les philosophes hellènes de l’Antiquité, ces principes sont inconnus et totalement inconcevables. La vérité est établie lorsque tous sont unanimement d’accord et que chacun lui apporte son témoignage (à savoir lorsque tous partagent la même opinion et que chacun transmet sa propre expérience).
Commençons par un paradigme. Démocrite dit que, si j’affirmais, devant un pot de miel, que le contenu du pot est amer, on me dirait que je mens, que je m’éloigne de la vérité, et cela, non pas parce qu’il existerait, en dehors et au-dessus de nous, une force ou quelqu’un qui décide de ce qui est sucré et de ce qui est amer, mais tout simplement parce que l’expérience de chacun témoigne de ce que le miel est sucré. Par conséquent, si je soutiens le contraire, je ne me trouve pas en accord avec vous, car je ne partage pas votre expérience. Voilà donc où commence la démocratie pour les Hellènes de l’Antiquité : lorsque tous contribuent à l’épreuve commune pour que la vie soit véritable. La vérité ne relève donc pas de la majorité, mais du partage, du consensus sur l’expérience commune. Or la majorité est valide et porte une valeur réelle, lorsqu’elle sert de la vérité. Mais la majorité autonome ou autonomisante peut facilement détourner la vérité. C’est justement pour cela qu’on ne peut pas avoir majorité sans vérité. Dans le cas contraire, la majorité peut facilement servir le mensonge ou l’aliénation…
B. De la Théologie ecclésiale
Nous sommes maintenant invités à faire une distinction entre “démocratie” et “ecclésialité”. L’Église relève-t-elle du démocratique ? On peut tout aussi bien répondre “oui !” que “non !”. “Oui”, parce que l’ecclésialité porte en elle et représente l’idéal démocratique comme modus vivendi socio-personnel et socio-universel. “Non”, dans la mesure où la démocratie suppose une dimension unique, la dimension horizontale (démo-cratie), cependant que lui échappe la dimension verticale. En d’autres termes, la démocratie est incompatible avec la vie du corps ecclésial, car elle demeure éonistique et représente un monophysisme — sinon politique, tout au moins — théologique. Elle peut s’accomplir et est complète comme système poli-tique, mais elle demeure néanmoins déficitaire, lorsqu’elle prétend notamment se substituer à l’ecclésialité divino-humaine, qui demeure pour ceux qui arrivent à la vivre (méthexis-participation), la voie vitale aussi bien pour le “siècle présent” que pour le “siècle à venir”…
Par ailleurs, la démocratie demeure profondément choisie mais certainement pas charismatique . En effet, la démocratie refuse le charisme : elle fait découler l’autorité de la volonté populaire. Dans l’Église, la qualité épiscopale est charismatique (même si le peuple a choisi son évêque), car l’évêque reçoit un ministère (charisme constitutif et récapitulatif de son Église locale) par un saint Mystère (chirotonie) de l’Église, et il l’exerce en communion synodale avec l’ensemble des évêques de l’Église, en participant à un synode local. La notion théologique de la synodalité est bien autre chose que la démocratie. Enfin, la démocratie prétend se justifier par l’humanisme. Mais elle nous propose un humanocentrisme qui se trouve à l’opposé du théanthropisme chrétien : l’homme-Dieu veut substituer au Dieu-homme…
C’est cependant un lapsus de qualifier l’Église par cette notion, parce qu’elle est autrement. Le ‘démo-cratique’ constitue certes une haute conception humaine de la vie poli-tique = publique (et par suite du droit) dans une perspective foncièrement horizontale (démos) qui concerne l’implantation d’une “société parfaite” ayant comme but le service de l’homme — l’“être démocratique”, noyau essentiel de cette perspective — dans des relations d’égalité (droits-kratos [état]) et de respect réciproque (obligations-démos) communément imposées et acceptées par le même démos [cf. la conception contemporaine des Droits de l’Homme et du dualisme imposé : droits-obligations, qui découle de ceux-là).
Mais, ‘l’ecclésial’ est en dehors de cette dimension et loin aussi de toute “ecclésio-cratie”. Pourquoi ? En tant qu’événement constituant une communauté historique comme réalité eschatologique dans l’histoire — et c’est une réalité qui advient constamment en Christ et dans l’Esprit Saint —, l’ecclésialité est autrement profonde et autrement vitale. En tant qu’in-stitution dans l’histoire, l’Église, relève du droit “non démo-cratique” mais “théo-cratique”, ou plutôt “théo-andrique” [voire divino-humain]. Or, ce “théo-” de l’Église n’est donné qu’en Christ (dans l’Esprit Saint) et la réalité “Christ” (ou mieux, l’événement-Christ) implique à la fois la réalité humaine dans son intégralité et la réalité divine, “sans mélange, ni confusion” et “sans séparation, ni division” . Le “Je” de l’Église ne représente pas un aspect distinct de celui que désigne le “Je” du Christ Lui-même. En tant que réalité pleinement horizontale et verticale à la fois, l’Église n’a cependant pas son droit (ni son “Je”) par elle-même, et elle ne le tient pas non plus du “démos ecclésial”. Bien qu’elle assure une communion profonde entre les hommes, cela ne se réalise qu’en passant à travers la communion mystérique avec Dieu .
Ici encore, il suffit de regarder ce que sont les “rapports de l’homme avec les autres hommes, ses prochains [synanthropes], et avec Dieu” (Abba Dorothée) : l’Église, comme le et en tant que Royaume — et les icônes aussi d’ailleurs — devient, en fin de compte, une réalité explicitement uni-dimensionnelle (comme effectivement le cercle de l’abba Dorothée…). Nous avons là la dimension du Royaume à venir, où l’incréé est en pleine communion ontologique avec le créé.
L’Église, en effet, a comme but la plénitude eschatologique, déjà inaugurée dans l’Histoire : le Royaume qui est “déjà là et pas encore” réellement présent, bien que caché . Ainsi, l’“être démocratique” et l’“être ecclésial” ne peuvent jamais être comparés entre eux. Le premier — strictement historique — pouvait s’inscrire dans le deuxième — qui reste bien foncièrement eschatologique — et c’est pour cette raison que l’historique ne peut jamais être confondu avec l’eschatologique et encore moins le supplanter… Or il ne faut jamais oublier que l’aspect démocratique demeure décidément une réalité historique, mais manifestement une utopie eschatologique…
C. De la Tradition canonique conciliaire
Lors des Conciles ecclésiaux, locaux ou œcuméniques, si les évêques se rassemblent, ce n’est pas dans le but d’exposer leur opinion ou leur “position” ou encore — comme l’on dit couramment — leur “point de vue” et imposer ainsi leur propre gré par le biais du principe de majorité, c’est pour manifester et témoigner l’expérience vécue, tant en raison de leur expérience personnelle par participation au corps mystique du Christ qu’à cause de l’expérience du corps ecclésial qu’eux-mêmes récapitulent. C’est pourquoi il a pu arriver que des Conciles locaux œcuméniques qui avaient réuni certains d’évêques — qui, parfois, représentaient la majorité — aient été, par la suite, rejetés par la « conscience » de l’Église ; les évêques sont rentrés dans leurs provinces et le corps ecclésial les a, tout simplement, renvoyés, non qu’ils aient violé quelques principes idéologiques, mais parce qu’ils ne le représentaient pas. Il en va d’une certaine manière comme du miel. “Si tu nous dis qu’il est amer, nous te coupons de la communauté [cf. la formule canonique : “exclu de la communion”], nous te refusons”…
C’est justement là qu’on doit rappeler une chose. L’Église marche sur les traces des saints et s’exprime par leur bouche. Les saints ne sont pas des individus, ce sont des personnes. La différence n’est pas seulement théorique : lorsqu’un homme est véritable, notre humanité tout entière en est agrandie. Nous voyons donc en la personne du saint celui que nous souhaitons tous devenir et, puisqu’il a réussi, tous peuvent réussir. Lorsqu’on voit un homme saint, on se sent être en lui. Il nous emmène avec lui et nous mène un peu plus loin…
C’est d’ailleurs le principe de l’unanimité, posé à la base de la vie et de l’expérience ecclésiales, du vécu et de la participation à l’expérience de la Révélation au cours des siècles, qui a été retenu dans les synodes de l’Église primitive et ancienne comme le critère décisif des décisions synodales. Il est remarquable que les Conciles qui se sont déjà tenus à l’époque de saint Cyprien semblent bien avoir été régis par le principe d’unanimité. Cette pratique était bien retenue au cours des trois premiers siècles.
C’est néanmoins à partir du 4e siècle que cette réalité ecclésiale prend une autre forme ou plutôt un autre contenu. En effet, les canons du 4e siècle, dont nous pourrions nous servir pour l’étude de ce problème, reflètent le passage — et cela après la date-charnière de l’Édit de Milan (313) — de l’unanimité synodale à la majorité synodale. Ce sont le 6e canon du Ier Concile œcuménique de Nicée (325) et le 19e canon du Concile local d’Antioche (341). Ce qui est fort intéressant c’est que ce même Concile local d’Antioche confirme aussi bien l’unanimité synodale (canon 15 : « […], que tous les évêques de l’éparchie ont été unanimes à porter un jugement ») que la majorité synodale (canon 19 : « […], que l’on observe le vote de la majorité »), fait qui reflète justement cette transformation au cours du 4e siècle. Mais ce n’est pas le principe d’unanimité, qui demeure un donné canonique et qui doit être examiné ici, mais, au contraire, c’est le principe de majorité, qui doit être examiné et analysé en priorité.
Tout d’abord, le texte du 6e canon du Ier Concile œcuménique de Nicée parlant de l’élection des évêques, in fine, est ainsi conçu :
« […]. D’autre part, l’élection épiscopale ayant été faite en commun avec discernement et d’une manière conforme au canon ecclésiastique, même si deux ou trois font de l’opposition par pur esprit de contradiction, que l’on observe le vote de la majorité .
Le deuxième canon, que nous devons également examiner ici, fait alors un pas en avant en direction du renforcement du pouvoir du Synode. Le 19e canon d’Antioche renvoie également aux élections et aux consécrations des évêques qui apparaissent liés à la formation de l’institution synodale. Nous lisons dans ce canon :
« Un évêque ne peut être élu sans synode et sans la présence de l’évêque métropolitain de l’éparchie ; en plus de la présence indispensable de celui-ci, il est en tout cas nécessaire que soient présents tous les évêques co-célébrants de l’éparchie, que l’évêque métropolitain aura convoqués par lettre. Si tous viennent, ce sera pour le mieux ; si cela est difficile, il faut absolument que la majorité des évêques soit présente ou qu’elle envoie par écrit son assentiment à la consécration en sorte que la chirotonie ait lieu soit en présence de la majorité soit avec son approbation écrite. Si l’on contrevient à cette ordonnance, la chirotonie n’aura aucune valeur. Si au contraire, tout se passe selon cette ordonnance, et que quelques-uns s’y opposent par esprit de contradiction, que l’on observe le vote de la majorité .
Dans le 6e canon du Ier Concile œcuménique de Nicée ainsi que dans le 19e canon du Concile local d’Antioche, c’est donc bien du principe de majorité qu’il est fait mention, mais uniquement à titre de recours ultime, et à la condition que les mobiles des opposants soient bas et intéressés. Sinon, les Conciles/Synodes, prenant leurs décisions à la majorité, et non à l’unanimité, peuvent voir leur autorité contestée, à moins qu’il ne soit prouvé, ainsi que le prévoit le 19e canon d’Antioche, que la minorité a agi en raison d’une “querelle particulière”. Autrement dit, c’est à partir du 4e siècle que l’Église “devient”, petit à petit, plus …“majorito-cratique” ou plus …“arithmo-cratique”, et donc plus …démo-cratique !…
C’est en effet que « si nous comparons le 19e canon d’Antioche au 4e canon du Ier Concile œcuménique, qui fait également référence aux élections et aux chirotonies des évêques, il apparaît clairement que le canon d’Antioche constitue, avec une hésitation notable, un pas en direction du renforcement du pouvoir du Synode au détriment de l’Église locale. Ce pas important consiste en l’introduction (pour la première fois ?) du principe de majorité dans l’institution synodale. Ce principe soulève de sérieux problèmes ecclésiologiques, parce qu’il sous-entend que la quantité est un critère décisif de l’unité de l’Église, ce qui va à l’encontre du caractère (“éthos”) de l’Ecclésiologie ancienne (il est très probable qu’à cette époque, les hérétiques étaient majoritaires). Le principe de majorité, qui se trouve à la base du droit séculier des régimes démocratiques, risque de transformer l’institution synodale en une institution purement juridique ; c’est la raison pour laquelle il n’avait pas été appliqué dans les synodes de l’Église ancienne, sauf lorsque toutes les tentatives de parvenir à l’unanimité s’étaient avérées infructueuses » . C’est le même problème qui est posé de nos jours par l’insistance que mettent certaines Églises patriarcales ou autocéphales orthodoxes sur le nombre des fidèles pour revendiquer par la suite soit des droits de préséance dans la taxis canonique de l’Église soit des droits de responsabilité au sein de la “diaspora” orthodoxe. [Cf. le “Mythe des grands et des petits”…].
De plus, « les synodes qui expriment l’unanimité et la communion de tous les évêques “répandus à travers tout l’univers”, jouissent d’une validité et d’une autorité suprêmes, étant donné que ces synodes ont été finalement approuvés par le “Amen” du peuple de Dieu. C’est de cette manière que l’institution synodale pourra retourner à sa source, qui est aussi la source et l’expression ultime de toute l’unité de l’Église, c’est-à-dire à la communion eucharistique. De même que, dans la divine Eucharistie, le “Amen” du peuple de Dieu se trouve parmi les conditions sine qua non définissant la substance ecclésiologique des actes célébrés (pour les Orthodoxes, il n’est pas permis que la divine Eucharistie soit dite par le prêtre seul), de même dans le système synodal, le consentement du peuple est indispensable. Il faut cependant souligner que l’autorité et la validité des décisions et des actes synodaux ne prennent pas leur source dans le peuple (comme il advient dans la démocratie), mais en Dieu par l’intermédiaire des évêques, dans la communion de l’Église » .
* * * * *
Voilà donc quelques mots concernant le rapport existant entre la démocratie et l’ecclésialité, qui peut être un critère manifestement flagrant pour notre mode de participation (méthexis) à l’événement unique de la vie ecclésiale. Il serait néanmoins intéressant que nous puissions consacrer un bon moment pour aborder deux autres aspects qui vont en fait de pair et dans le même sens que ce que nous venons d’examiner. Il s’agit, d’une part, “de la démocratie et de l’amour” et, d’autre part, “de la démocratie et de la vie monastique”. Aborder ces deux aspects revient à aborder la question de la démocratie et de la …mort ; autrement dit, il s’agit des questions de la confirmation absolue de la vie après la chute d’une part, et, d’autre part, de la transcendance voulue et volontaire de cette chute et de la mort…
Archimandrite Grigorios D. Papathomas,
Doyen du Séminaire Orthodoxe St Platon de Tallinn .