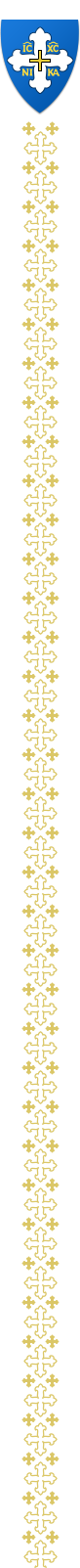Avaleht/Droit Canon/Au temps de la Post-Ecclésialité
Au temps de la Post-Ecclésialité
Viimati muudetud: 06.03.2015
La naissance de la modernité post-ecclésiologique
De l’Eglise Une aux nombreuses Eglises, et donc De la dispersion de l’Eglise à l’anéantissement du Corps du Christ
Le 16e siècle ouvre une période nouvelle dans l’Histoire et la Théologie de l’Eglise et du Christianisme. Une période que nous pourrions littéralement qualifier de “post-ecclésiologique” pour les raisons que nous examinerons plus bas. Le début de cette période est marqué par la Réforme (1517), quoique des signes précurseurs soient bien sûr apparus beaucoup plus tôt, notamment dans l’Ecclésiologie née au temps des Croisades (1095-1204).
Les cinq siècles qui ont suivi (16e-20e siècles) nous livrent suffisamment d’éléments historiques et de données théologiques pour bien cerner cette époque nouvelle, cette innovation ecclésiologique de création récente – par rapport à une pratique ecclésiologique antérieure totalement différente – mais aussi un nouveau concept inconnu jusqu’alors, qui marque la fin de l’Ecclésiologie que l’Eglise avait vécue et exprimée dès sa fondation et au cours des quinze premiers siècles.
Après cette déviation ecclésiologique constatée et son entrée dans les faits, et non pas en raison de quelque évolution ecclésiologique, dans cette époque “post-ecclésiologique”, il est naturel qu’aient vu le jour des ecclésiologies nouvelles et variées, telles que des ecclésiologies confessionnelles (Protestants), des ecclésiologies ritualistes[i] (Catholiques) et des ecclésiologies ethno-phylétiques (Orthodoxes), ou mieux, pour respecter leur ordre d’apparition historique, des ecclésiologies ritualistes, puis confessionnelles puis ethno-phylétiques. Il s’agit en fait d’ecclésiologies hétéro-collectives, qui se sont constituées selon des principes militants, qui, dominantes depuis lors, non seulement caractérisent toute la vie ecclésiale, mais aussi dictent les textes statutaires réglant l’existence et le fonctionnement des Eglises de l’ensemble de cette époque et d’aujourd’hui.
De nos jours, nous sommes dans une situation historico-théologique qui peut nous permettre de prendre un certain recul vis-à-vis des événements du passé historique ecclésiastique et de réviser les causes qui ont provoqué les divergences ecclésiologiques. Nous nous proposons d’examiner maintenant, dans un esprit purement dialectique et critique, dépourvu de toute tentation polémique, ces trois ecclésiologies qui, différentes quant à leur origine et leur perspective, présentent néanmoins un dénominateur commun et, finalement, se ressemblent, se côtoient et co-existent, sans toutefois communier ni s’unifier. Le dénominateur commun réside dans le terme et dans le fait de la co-territorialité, qui pose un problème ecclésiologique des plus graves, s’inscrivant dans tout le deuxième millénaire, ce millénaire qui a été confronté à diverses questions insolubles, d’ordre exclusivement ecclésiologique, contrairement au premier millénaire qui avait posé des questions christologiques, résolues pour la plupart. En d’autres termes, lorsque se posait un problème christologique, l’Eglise du premier millénaire a su intervenir conciliairement et la résoudre, ce qui, ainsi qu’on l’a vu par la suite, n’a pas été le cas au deuxième millénaire. Ces trois ecclésiologies sont donc les suivantes :
- L’Ecclésiologie des Croisades (13e siècle)
- L’Ecclésiologie de la Réforme (16e siècle)
- L’Ecclésiologie de l’Ethno-phylétisme (19e siècle)
Examinons à présent plus en détail cette trilogie ecclésiologique jumelle tripare, nouvellement apparue et totalement hétéro-centrique.
1. L’Ecclésiologie des Croisades (13e siècle)
En tant que fait ecclésiologique, la rupture réciproque de communion ecclésiale de 1054 ne concernait que deux Patriarcats de l’Eglise, le Patriarcat de Rome et le Patriarcat de Constantinople. Toutefois, cette rupture s’étendit de fait aux autres Patriarcats d’Orient, après que les Croisés eurent qualifié la rupture de schisme. Il s’est en effet révélé a posteriori que l’usage de ce terme renvoyait à une situation radicalement nouvelle qui, d’un point de vue ecclésiologique et canonique, pouvait légitimer la fondation à nouveau d’Eglises homonymes sur les territoires des Patriarcats et Eglises d’Orient préexistants, étant donné qu’à elle seule, la rupture de communion ne pouvait rien légitimer de tel.
En effet, le mouvement politique des Croisades conféra une autre portée à la rupture de communion de 1054. En proclamant le schisme, entendons un fait canonique qui considère une partie du corps ecclésial comme détaché de l’ensemble du corps et, par conséquent, inexistant pour un lieu donné, imprima une autre direction au nouvel ordre des choses ecclésiologique qu’il instaurait. Se sont ainsi formées deux catégories d’Eglises à côté des anciens Patriarcats d’Orient. Des Patriarcats homonymes latins se constituent en Orient (le Patriarcat latin de Jérusalem [dont la formation remonte à la fin de la Première Croisade-1099], suivi immédiatement par le Patriarcat latin d’Antioche [1100], puis l’Eglise catholique non-autocéphale[ii] de Chypre [1191], etc.), et ce fait, en lui-même – si l’on admet qu’il s’agit d’une rupture de communion et non d’un schisme – engendre implicitement, mais officiellement au sein de l’Eglise le problème ecclésiologique de la co-territorialité (1099).
Cependant, l’apparition de cette innovation qu’est le concept de “co-territorialité” n’en reste pas là. À côté de ces entités ecclésiastiques latines se constituent des Patriarcats ritualistes latins et des Eglises catholiques orientales (Patriarcats maronite, melchite, syrien catholique, etc.), placés sous la juridiction transfrontière (hyperoria) et hiérarchiquement isocèle (équivalente) du Patriarcat et du Pape de Rome, et cela, sur un seul et même territoire.
La juridiction devenait ainsi transfrontière (hyperoria) – toujours dans le cas d’une rupture de communion – parce que de nouveaux Patriarcats de rite latin et ritualistes “orientaux” étaient ainsi créés sur le territoire canonique d’une Eglise d’Orient, mais elle devenait aussi isocèle, en ce sens que, même si ces Patriarcats étaient égaux entre eux, ils étaient cependant tous subordonnés et placés dans une situation de commune dépendance à l’égard du Patriarcat de Rome. Cette aberration ecclésiologique, nouvelle elle aussi, s’est maintenue jusqu’à nos jours (cf. l’existence de deux différents types d’Eglises sur le même territoire (conviventia), mais aussi de deux Codes de Droit canonique totalement indépendants et non communiquants l’un de l’autre). C’est également l’époque où apparaît une nouvelle version de la Primauté du Patriarche et Pape de Rome et assez différente par rapport à l’expérience ecclésiologique du premier millénaire. On peut considérer que Patriarche et Pape de Rome est de fait un “Primus inter inferiores” [Primauté mono-juridictionnelle universaliste], alors que, dans l’Ecclésiologie et la praxis de l’Eglise du premier millénaire, le Premier Patriarche (le Président) de la communion ecclésiale de cinq Patriarcats (Pentarchie conciliaire) issus du IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451), était un “Primus inter pares” (Primauté synodale communionnelle). Une structure de type pyramidal vient se substituer à une structure de type constellation. Mais là c’est une autre question qui déborde la perspective du présent texte.
À partir du 13e siècle, l’ecclésiologie de l’Eglise catholique de cette époque introduit, pour la première fois dans l’histoire, une forme ecclésiologique (fondation d’une Eglise en un lieu) de double co-territorialité : d’un côté, co-territorialité avec des Patriarcats avec lesquels elle se trouve ou non en rupture de communion et, de l’autre, co-territorialité avec d’autres Eglises auto-constituées et de ritus différent. Ces dernières, cependant, se trouvent en totale communion ou, comme on le dit couramment, rattachées ou unies à Rome, mais, toutes ensemble, elles coexistent en tant que corps et entités ecclésiastiques sur un seul et même lieu. C’est ainsi que nous en arrivons, dès la fin du Moyen Âge, à avoir des Eglises catholiques de rite différent sur un seul et même territoire. Telle est ce qu’on pourrait appeler la co-territorialité d’origine intérieure (ad intra). Cependant, il se trouve également un Patriarcat latin catholique avec d’autres Patriarcats ritualistes catholiques romains, là où existe déjà un Patriarcat – rappelons, par exemple, le cas – de Jérusalem. Voilà la co-territorialité d’origine extérieure (ad extra), et donc toutes les deux simultanément.
Cette double co-territorialité, qui résultait de la situation politique créée par les Croisades, s’imposa et se perpétua avec cette structure homogène jusqu’à la Réforme. En d’autres termes, du 13e au 16e siècle, nous avons, d’une part, mono-territorialité et mono-juridiction ecclésiastique en Europe occidentale, sur le territoire du Patriarcat de Rome, cependant que, d’autre part, simultanément ce même Patriarcat encourage à la co-territorialité ecclésiastique et, par suite, à l’exercice d’une (multi)juridiction transfrontière (hyperoria) sur les territoires des autres Eglises d’Orient, sur lesquels s’instaure désormais une co-territorialité à la fois extérieure (extra-communionnelle) et intérieure (intra-communionnelle). Dans ces idiomes ecclésiologiques nouvellement nés, on pouvait dépister aussi les prémices d’une ecclésiologie universaliste développée ultérieurement – et notamment juste après la Réforme…
Toutefois, en dépit des pressions politiques de cette époque, une autre position persiste au cours de ces siècles dans le monde chrétien occidental, une position théologique, animée par le souhait d’un rétablissement de la communion ecclésiale et du règlement du problème ecclésiologique. Les deux Conciles, p. ex. de Lyon (1274) et de Ferrare-Florence (1438-39), qui rassemblèrent des évêques – notons que, durant ces Conciles, ils s’appelaient mutuellement frères – qui se trouvaient en situation de rupture de communion et non de schisme (autrement, il n’y aurait eu aucune raison de convoquer de tels Conciles), mais aussi le fait que des moines d’Occident continuèrent à s’installer au Mont Athos jusqu’aux débuts du 14e siècle, montrent clairement qu’une solution ecclésiologique à la rupture de communion étaient encore vivement désirée, malgré tous les comportements de co-territorialité qui étaient dictés par la politique, mais qui alors pouvaient encore être affrontés…
2. L’Ecclésiologie de la Réforme (16e siècle)
C’est la Réforme qui fit apparaître le problème ecclésiologique de la co-territorialité sur le territoire du Patriarcat et de l’Eglise de Rome. En effet, au 16e siècle, cette aliénation ecclésiologique qu’est la co-territorialité se transmet pour la première fois en Europe centrale et occidentale et fragmente le Patriarcat de Rome intérieurement et territorialement, exactement de la même façon que les autres Patriarcats d’Orient avaient été auparavant fragmentés intérieurement. Il vaut la peine de rappeler[iii] à ce propos que, cette fois, la co-territorialité a émergé sous une forme confessionnelle et a largement contribué à l’aggravation de ce problème ecclésiologique. C’est alors qu’on vit apparaître le terme “dénomination” dans le domaine de l’ecclésiologie.
L’expérience ecclésiologique du premier millénaire était que, dans un lieu donné, l’unique critère canonique permettant la fondation et l’existence d’une Eglise “locale” ou “établie localement” était la territorialité exclusive et la mono-juridiction ecclésiologique. Or la Réforme, en raison de son éloignement de l’Eglise occidentale, dont elle “était issue”, non tant du point de vue spatial que surtout du point de vue de son mode d’existence, introduit par définition une nouvelle donnée déterminante pour la fondation d’une Eglise, élément inconcevable jusqu’alors du point de vue ecclésiologique et canonique. En effet, les Communautés ecclésiales nouvellement nées, qui se formèrent à cette époque et dont l’existence était purement autonomisée, avaient besoin, en raison de leur différence confessionnelle, d’une hypostase ecclésiologique, qui, toutefois, ne pouvait être fondée ni sur l’expérience ecclésiologique de l’Eglise, telle qu’elle était vécue jusqu’alors, ni sur la structure institutionnelle de l’Eglise locale-diocèse. La raison en est simple : ces Communautés commencèrent à se former et à co-exister sur un territoire où existait déjà une Eglise, qui plus est une Eglise possédant une identité territoriale ecclésiologique (Eglise en un lieu-Ecclesia in loco : Eglise ‘qui est à Rome’).
Il était cependant impératif de trouver un moyen, d’une part, de faire de ces Communautés une Eglise, ce qui était d’ailleurs l’objet de la Réforme, et, d’autre part, un élément permettant de les différencier d’avec l’Eglise existante, avec laquelle elles ne voulaient justement plus être identifiées. L’adoption d’une désignation locale quelconque aurait semé la confusion, d’autant plus qu’il aurait été nécessaire d’adopter les mêmes structures institutionnelles (évêque, diocèse et nom de lieu). On ne pouvait donc plus procéder comme l’avaient fait les Croisades, puisque celles-ci avaient a priori ouvertement proclamé le schisme (sic), qui permettait légitimement de reprendre, telles quelles, les structures et les désignations territoriales des Patriarcats et Eglises d’Orient.
En ce qui concerne la Réforme, de même qu’elle n’avait pas proclamé de schisme avec l’Eglise d’Occident, dont elle était “issue”, de même elle ne s’engagea pas dans un processus ecclésiologique de rupture de communion ni rien d’approchant. La Réforme visait à l’acquisition d’un fondement ecclésiastique, mais, en tant que Réforme, tenait aussi absolument à se distinguer de l’Eglise existante. Dans le Luthérianisme et le Calvinisme, c’est-à-dire dans le Protestantisme principalement traditionnel, où prévaut le dogme, on observe une dépendance de l’Eglise, exclusivement par rapport à la Confession de Foi (Confessio Fidei [cf. Confession d’Augsbourg-1530]). C’est pourquoi la Réforme choisit, fatalement mais aussi nécessairement, de se désigner par une épithète, un déterminant adjectival provenant de la confession de chaque chef protestant, ce qui évitait l’emploi d’une désignation locale. C’est ainsi que naquit le besoin du confessionalismus au sein de l’Ecclésiologie de même que la confessionalisation de l’Eglise, tout d’abord dans l’espace protestant, puis au-delà. En bref, la scission de l’unité ecclésiologique en Occident donna naissance au confessionalisme et détermina la désignation des Eglises naissantes, laquelle n’était plus territoriale, mais confessionnelle. Non pas une référence locale donc, mais une détermination de confession et de déterminant adjectival (p. ex., Eglise luthérienne, Eglise calviniste, Eglise méthodiste, Eglise évangélique, etc.).
Pour récapituler, la Réforme, même si ce n’était pas son objet principal, élargit et systématisa la co-territorialité comme forme d’existence ecclésiologique, mais, par la suite, son auto-fragmentation en plusieurs et diverses Eglises confessionnelles conduisit au même symptôme d’aliénation de l’Ecclésiologie. D’une manière étonnamment semblable, elle produisit à son tour ce même symptôme ecclésiologique de la double co-territorialité : co-territorialité externe (extra-communionnelle) en raison de la coexistence de toutes les Eglises protestantes confessionnelles à côté de l’Eglise catholique dont elle sont issues, mais aussi co-territorialité interne (intra-communionnelle) vu que plusieurs Eglises protestantes coexistent sur un même lieu et dans la même ville (conviventia), sans qu’elles parviennent à la plénitude de communion du corps ecclésial se trouvant en un lieu donné, cette communion – idéal qui nous était cependant bien proposé par l’Ecclésiologie paulinienne du Nouveau Testament, fondement exclusif de l’ecclésiologie protestante (sola scriptura et fundamentum fidei). Or il n’y a pas de mono-confessionalité au sein de la Confession protestante, initialement une et unique, mais d’auto-fragmentation et de prolifération confessionnelles. Ainsi, bien que le protestantisme se fonde sur l’Ecclésiologie paulinienne et la proclame vigoureusement seule vérité néo-testamentaire, non seulement il porte en son sein l’ecclésiologie confessionnelle de la co-territorialité, ce qui efface toute trace de la vision paulinienne et néo-testamentaire relativement à la fondation d’une Eglise en un lieu donné, mais de plus il relativise la position répétée, et pourtant soulignée avec persistance à maintes reprises, de la sola scriptura.
3. L’Ecclésiologie de l’Ethno-phylétisme (19e siècle)
Pour les Orthodoxes, la situation est encore plus complexe et nous pourrions nous y arrêter un long moment. Nous nous limiterons cependant à deux aspects : a) l’existence d’une co-territorialité intérieure (intra-communionnelle) dans l’ecclésiologie orthodoxe, à laquelle s’ajoute une deuxième caractéristique ecclésiologique négative, la multi-juridiction, mais aussi b) la non-existence d’une co-territorialité extérieure (extra-communionnelle). Commençons par la seconde, vu que, en pratique, le choix de cette position ecclésiologique est historiquement antérieur.
Avant tout, malgré les points de vue contradictoires qui divisent aujourd’hui les Orthodoxes, l’année 1054, pour l’Eglise orthodoxe, ne fut pas qualifiée de “schisme”, mais d’une “rupture de communion”. Jamais l’Eglise orthodoxe ne proclama de schisme tout au long du deuxième millénaire. Parce que, en dehors du fait que « Tout schisme durable devient une hérésie » (Jean Chrysostome) et que, par conséquent, le détachement devient total d’avec le corps ecclésial, l’Eglise orthodoxe, s’il y avait eu schisme, aurait dû suivre le même processus ecclésiologique que l’Eglise de Rome après les Croisades, et constituer un “Patriarcat orthodoxe de Rome”, ce que, absolument conséquente avec elle-même, elle n’a pas fait pendant un millénaire et que, heureusement, elle refuse toujours énergiquement de le faire. Par ailleurs, pour la même raison, elle n’aurait pas dû accepter que se tiennent les trois Conciles communs du deuxième millénaire et, encore moins, d’y participer (Lyon [1274]-Ferrare-Florence [1438/39]-Brest-Litovsk [1596]). (Il se trouve, d’ailleurs, que le troisième Concile, celui de Brest-Litovsk (1596), a été convoqué au même siècle que le début de la Réforme. Toutefois, après le Concile de Trente (1545-1563), qui donna le coup de grâce à toute tentative d’unité, et à partir du 17e siècle, le bouleversement des données ecclésiologiques au sein de l’Eglise catholique, conjointement aux guerres de religion en Occident, engendra d’autres priorités et les choses prirent une autre tournure, ce qui est clairement apparu lors de Vatican II (1962-64) ).
Par conséquent, en employant le terme de “schisme” pour caractériser 1054, les Orthodoxes commettent une erreur ecclésiologique. C’est encore là une caractéristique de la « captivité babylonienne de la Théologie orthodoxe » (G. Florovsky). En conséquence, le refus de l’Eglise orthodoxe de déclarer la “rupture de communion de 1054” comme un “schisme”, ainsi que le refus conséquent, par extension, de constituer un “Patriarcat orthodoxe de Rome”, prouvent qu’elle a longtemps vécu et vit toujours dans l’espoir tenace du rétablissement de la communion et que, pour cette seule et unique raison, elle ne pratique pas de co-territorialité extérieure. Nous devons donc reconnaître ici que, sur cette question, l’Ecclésiologie paulinienne, de même que l’Ecclésiologie conciliaire et patristique “d’une seule Eglise en un lieu” sont restées intactes dans l’Eglise orthodoxe et son ecclésiologie.
Cependant, il n’en va pas de même de la co-territorialité intérieure chez les Orthodoxes. Nous devons même ajouter qu’à cet égard, les Orthodoxes ont surpassé les Catholiques et les Protestants pour ce qui est des déviations ecclésiologiques, car, outre la co-territorialité, ils exercent aussi une co-juridiction ainsi qu’une multi-juridiction de fait multilatéraliste et hyperoria. (Nous prétendons être en communion, sans toutefois qu’il existe de communion réelle, puisque, comme nous en verrons la raison, chaque Eglise ethnique, avec un soin et une vigilance extrême, privilégie l’acquis ethno-phylétique et non la communion ecclésiologique). C’est justement là que l’on peut constater, dans l’ecclésiologie orthodoxe contemporaine, qu’il s’agit d’une ecclésiologie non dépourvue de stratifications et de déviations symétriques. Ceci apparaît non seulement dans la pratique ecclésiologique orthodoxe répandue dans le monde d’aujourd’hui, mais cela va même jusqu’à s’inscrire explicitement et juridiquement dans la praxis statutaire des Eglises nationales orthodoxes, ainsi que nous allons le voir dans un instant. Un double exemple de dispositions statutaires de contenu non ecclésiologique suffira à lui seul à mettre en relief le problème ecclésiologique dans toute sa grandeur. Contentons-nous ici de rappeler de nouveau un article des Chartes statutaires d’une Eglise hellénophone et d’une Eglise slavophone, en l’occurrence la Charte statutaire de l’Eglise de Chypre et celle de l’Eglise de Russie, afin de les placer dans la perspective de notre recherche ecclésiologique.
« Les membres de l’Eglise orthodoxe de Chypre sont :
– tous les Chypriotes chrétiens orthodoxes, qui sont entrés dans le sein de leur Eglise orthodoxe par le baptême, résidant en permanence[iv] à Chypre, ainsi que
– tous ceux qui, d’origine chypriote[v], résident à ce jour à l’étranger » (Article 2, Charte statutaire de l’Eglise de Chypre-1980)[vi].
« La juridiction de l’Eglise orthodoxe russe est étendue :
– aux personnes de confession orthodoxe résidant en URSS [1988] ; résidant sur le territoire canonique de l’Eglise orthodoxe russe [2000], ainsi que
– aux personnes[vii] qui résident à l’étranger et qui acceptent volontairement sa juridiction » (Article I, § 3, Charte statutaire de l’Eglise de Russie-1988 et 2000)[viii].
Les articles en question sont représentatifs de Chartes statutaires partageant trois principales caractéristiques non ecclésiologiques :
a) La juridiction de ces Eglises s’exerce sciemment et avant tout sur des personnes – comme dans l’ecclésiologie de la Réforme… – et non exclusivement sur un territoire. Autrement dit, il est possible d’affirmer sans plus d’analyse que l’exercice d’une juridiction ecclésiale sur des personnes signifie tout simplement que ce fait statutaire donne, à lui seul et par définition, à ces Eglises le droit de pénétrer dans les frontières canoniques des autres Eglises établies localement… Alors que nous savons tous que l’autocéphalie, en conformité avec l’ecclésiologie paulinienne, est octroyée à un lieu donné, à un territoire qui a des limites concrètes observant des critères géographiques – et de nos jours principalement géo-étatiques – et non à une nation. Or le contenu de l’autocéphalie est ainsi essentiellement celui du Nouveau Testament, opposé à l’Ancien dans la mesure où ce dernier identifiait le peuple élu avec la Nation. Par conséquent, la juridiction d’une Eglise autocéphale établie localement s’épuise sur un territoire concret et jamais à l’ensemble d’une nation, à plus forte raison à des personnes éparpillées et dispersées. Sur des “personnes” donc, et non sur un “territoire canonique” qu’elles invoquent certes, mais uniquement en situation de défense contre des “intrus” qui, conformément à leur Charte statutaire, s’apprêtent à exercer une co-territorialité externe (transfrontière-hyperoria) sur leur territoire. Et cela, dans le but d’empêcher, sur leur propre territoire, une intervention ecclésiastique extérieure justifiée par une autre juridiction (ou une autre “dénomination”) en vertu des mêmes principes, alors que elles-mêmes pratiquent statutairement un tel interventionnisme ecclésiastique de co-territorialité externe sur le territoire canonique des autres Eglises.
b) Les Eglises déclarent statutairement qu’elles ne sauraient admettre de limites, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice de leur juridiction aux territoires situés à l’intérieur de leurs frontières canoniques, ainsi qu’elles y sont tenues du point de vue ecclésiologique, puisqu’elles sont toutes deux des Eglises établies localement, et ainsi que l’exige d’ailleurs le principe de l’autocéphalie sur lequel repose leur existence ecclésiologique et institutionnelle. Au contraire, elles persistent à s’étendre au-delà de leurs frontières canoniques, alléguant que leur Charte statutaire leur en octroie le droit[ix]. Cependant, dans la pratique ecclésiologique, cela s’appelle ingérence institutionnelle, et surtout, confirmation institutionnelle et statutaire de la co-territorialité. En d’autres termes, il s’agit d’une tentative institutionnelle flagrante pour affermir la co-territorialité de manière ecclésiologique.
c) Plus important encore, ces Eglises, parlant des territoires situés hors de leurs frontières, sciemment et en tout état de cause, n’aperçoivent à l’extérieur de leur territoire canonique que des “zones de diaspora”, sans y reconnaître l’existence canonique d’autres Eglises établies localement – cependant tout aussi légitimes ou canoniques qu’elles. Par suite, la référence statutaire à des personnes anéantit la distinction canonique élémentaire de “territoires canoniques” et “territoires de Diaspora”, créant de ce fait non seulement la définition de la co-territorialité intérieure – fondée cette fois-ci sur une base statutaire – mais aussi un autre phénomène anti-ecclésiologique, une juridiction ethno-ecclésiastique universelle. Cet idiome ecclésiologique nouvellement né, comme d’ailleurs cela s’est passé avec l’Eglise catholique du Moyen Âge, commence à fonder une ecclésiologie universaliste mais fortement restreinte à un niveau national(iste) cette fois-ci, ou, mieux encore, provoque la naissance de plusieurs ecclésiologies universalistes nationales et la compétition entre elles.
Malgré la contradiction qu’en ressort, les Chartes statutaires des Eglises de Chypre et de Russie introduisent un double système ecclésiologico-canonique d’exercice de leur juridiction ecclésiastique, dualité inadmissible du point de vue ecclésiologique. Car :
- Du point de vue ecclésiologique, elles privilégient le “territoire canonique”, c’est-à-dire la territorialité et la mono-juridiction à l’intérieur des frontières du corps de l’Eglise établie localement.
Mais
- Du point de vue statutaire, elles revendiquent une “juridiction transfrontière (hyperoria)”, c’est-à-dire la co-territorialité et la multi-juridiction à l’extérieur des frontières du corps de l’Eglise établie localement.
Ce fait à lui seul constitue par définition une altération et une aliénation de l’Ecclésiologie de l’Eglise et engendre, en deux mots, si l’on peut se permettre l’expression, un bricolage (bric-à-brac) ecclésiologique. L’Ecclésiologie de l’Eglise du Nouveau Testament, des Canons et des Pères n’a, à ce sujet, rien de rien à voir avec les Chartes statutaires en question, et inversement. On confirme ainsi le fameux adage qui souligne les priorités éonistiques des Chrétiens : « Siamo primo Veneziani e poi Christiani ».
Il est cependant devenu tout à fait général de nos jours que les Eglises des nations de tradition orthodoxe se dotent de textes de nature statutaire et législative qu’elles considèrent comme l’équivalent ecclésiastique de la Constitution et des principaux codes de leur Etat (les Slaves parlent d’Ustav). Cette réglementation fixe les normes de fonctionnement hiérarchique de l’Eglise, ses structures de gouvernement (en général il y a un Synode restreint, ce qui n’est pas toujours canonique) et des dispositions d’ordre judiciaire et tentent de le faire mieux que les canons qui composent le Corpus canonum transmis par la Tradition diachronique de l’Eglise. Faut-il faire remarquer que l’apparent professionnalisme de ces textes est illusoire. Ils n’ajoutent aucune précision significative aux canons et recouvrent la nature inspirée de la structure canonique de l’Eglise d’une vaine apparence de rationalité systématique. Les canons sont l’explicitation d’une Tradition en réponse à des circonstances précises.
« Les temps sont accomplis »[x] et il nous faut prendre conscience que l’ecclésiologie statutaire des Eglises nationales orthodoxes est profondément problématique. La déficience des Chartes statutaires est moins sensible à l’intérieur d’un pays, mais l’innovation canonique d’un “territoire canonique” ethno-culturel – rappelant le principe juridique international du jus soli – laisse prévoir un bon nombre de désordres dans les pays situés en dehors des frontières et que nous appelons, à tort, la “diaspora”[xi]. La déficience de ces Chartes réside aussi en ce qu’elles présentent des éléments non pas seulement ethno-phylétiques, mais aussi confessionnels, juridiques, et surtout, non-canoniques et non-ecclésiologiques. Elles ressemblent, par la perspective qu’elles adoptent, aux pages d’un manifeste ethno-étatique plus qu’elles ne reflètent l’Ecclésiologie et la Théologie de l’Eglise. Ces textes statutaires officiels du 20e siècle témoignent encore une fois de la “captivité babylonienne” dans laquelle se trouve la Théologie de l’Eglise orthodoxe, prisonnière cette fois, du nationalisme étatique et de l’idéologie nationale dominante. Ils témoignent également de sa métamorphose en une ethno-théologie que l’Eglise a elle-même engendrée et qui a abouti à l’ethno-ecclésiologie, caractéristique principale de l’époque post-ecclésiale pour les Orthodoxes. Bien entendu, ce n’est pas un simple concept juridique qui caractérise l’époque, ce sont les réalités que ce terme reflète, où l’on peut dépister quelque chose de plus profond : de l’ethno-culturalisme (ethnoculturalismus) ecclésiastique.
Acteurs du “multilatéralisme” (multilateralismus), pour des raisons qui, aujourd’hui, nous sont connues, claires et évidentes, les Orthodoxes de notre époque blâment les Croisades des Chrétiens d’Occident, mais ils sont incapables de comprendre que leur position ecclésiologique les place, statutairement et institutionnellement, dans la suite des Croisades et de l’ecclésiologie qui en est issue. Un regard ecclésiologique – et non ethno-phylétique – sur les cas de co-territorialité, par exemple, en Estonie, en Moldavie ou dans l’ex-République yougoslave de Macédoine (fyrom), suffit à montrer la confusion ecclésiologico-canonique qui règne dans les espaces géoecclésiastiques orthodoxes d’aujourd’hui.
Pour compléter cette analyse, examinons une question de même type, cette fois en rapport avec l’esprit que répandent de telles dispositions statutaires de contenu ethno-phylétique et de perspective ethno-culturaliste.
« Par essence, l’Eglise a toujours été eucharistique et, en ce qui concerne un lieu, territoriale. La détermination géographique d’une Eglise, “locale” ou “établie localement”, comme les termes eux-mêmes l’indiquent, est l’unique catégorie de l’ecclésiologie conciliaire paulinienne, mais aussi de l’ensemble de l’ecclésiologie patristique qui lui a succedé. Le critère permettant de définir une communauté ecclésiale, un corps ecclésial ou une circonscription ecclésiastique a toujours été le lieu, et jamais une catégorie raciale, culturelle, ritualiste, nationale ou confessionnelle. L’espace est en effet la catégorie la plus inclusive de nos vies quotidiennes. Nous avions et nous avons encore une Eglise dans un lieu, à savoir une Eglise locale ou établie localement (p. ex. Eglise qui est à Corinthe[xii], Eglise de Galatie[xiii], Patriarcat de Jérusalem, Patriarcat de Rome, Eglise de Russie, etc.), mais nous n’avons jamais eu, comme aujourd’hui, d’Eglise suivie d’un adjectif qualificatif ou une Eglise épithétique (p. ex. Eglise corinthienne, Eglise galatienne, Eglise jérusalémite, Eglise romaine, Eglise russe, etc.). Et cela, parce que, dans le premier cas, il s’agit toujours de la même Eglise, mais incarnée en différents lieux (Eglise se situant à Corinthe, en Galatie, à Jérusalem, à Rome, en Russie, etc.), tandis que, dans le second cas, il n’apparaît pas clairement qu’il s’agisse de la même Eglise, puisqu’il est nécessaire de lui adjoindre un adjectif (représentant des catégories ethno-phylétiques ou confessionnelles) pour la définir et la distinguer d’une autre : nous disons ainsi Eglise serbe, Eglise grecque, Eglise russe, exactement de la même manière que nous disons Eglise évangélique, Eglise catholique, Eglise anglicane ou Eglise luthérienne. Et de même que, par exemple, l’Eglise luthérienne initialement, ayant perdu son assise locale “canonique”, pour des raisons confessionnelles et relatives à son expression identitaire, a eu recours à d’autres formes d’auto-définition, de même, dans l’espace de la “diaspora orthodoxe”, alors qu’il est absolument impossible de dire “Eglise de Serbie de France” ou “Eglise de Serbie en France”, ce qui serait inadmissible du point de vue ecclésiologique – parce que nous provoquons et nous sommes en pleine confusion des Eglises –, mais nous pouvons, pour des raisons purement ethno-phylétiques relatives à son expression ou d’exercice de sa juridiction ethno-ecclésiastique hyperoria, aisément dire – comme nous le disons non seulement oralement, mais aussi institutionnellement et statutairement – “Eglise serbe en France” »[xiv]…
La conclusion que nous pouvons tirer de cette brève analyse de la qualification ecclésiologique attributive est que nous avons une seule et unique Eglise à Corinthe, une seule et unique Eglise en Galatie, une seule et unique Eglise à Jérusalem. Cependant, il ne s’agit pas de trois Eglises, mais d’une seule Eglise, la seule et unique Eglise-Corps du Christ, qui se trouve à Corinthe, en Galatie et à Jérusalem. En ce sens, il n’existe pas et ne peut exister d’“Eglises sœurs”, car il n’y a pas deux corps distingués, mais une Eglise qui est et s’incarne en différents lieux. Dans ce contexte ecclésiologique, le mot “sœur” est totalement infondé, car il implique deux corps là où, sans aucune discussion possible, il n’y en a qu’un. Cette désignation n’existe pas dans l’Eglise du premier millénaire. L’emploi de ce terme suppose, et surtout sous-tend, des influences et des projections culturelles implicites dans le Corps un et indivisible de l’Eglise. En ce sens également, nous n’avons pas une Eglise russe, une Eglise bulgare, une Eglise jérusalémite ; ces Eglises seraient ainsi au nombre de trois. Par contre, nous avons une Eglise, une seule et unique Eglise-Corps du Christ, qui se trouve en Russie, en Bulgarie et à Jérusalem. Ainsi s’explique pourquoi les Chartes statutaires ethno-ecclésiastiques se dirigent, par leur position et par leur définition initiales, vers des perspectives divergentes – et non vers la communion des Eglises locales, comme c’était le cas pour les canons des Eglises qui étaient universellement communs et les mêmes pour tous.
Comparant les principes qui régissent nos trois ecclésiologies, nous constatons qu’elles présentent certains éléments extérieurs étonnamment communs. Chez les Catholiques, par exemple, c’est du rite que provient l’épithète désignant l’Eglise locale, à savoir “maronite”, “melkite”, “catholique grecque” ou “uniate”, etc. Chez les Protestants aussi, c’est de la confession que provient l’épithète désignant chacune des “dénominations”, à savoir “luthérienne” ou “calviniste”, etc. Pareillement et par analogie, ceci advient aussi dans l’Eglise nationale orthodoxe, où le messianisme de la Nation, autre forme de confession de foi, est, consciemment ou inconsciemment, accentué plus que tout autre aspect, et où, en même temps, on observe une relation et une dépendance affectives et même lascives de l’Eglise par rapport à la Nation et à l’idéologie nationale dominante. Il est, dès lors, naturel que ce soit de cette relation de dépendance réciproque par rapport à la Nation étatique que provienne l’épithète désignant les Eglises locales, à savoir Eglise serbe, Eglise roumaine ou Eglise russe.
Ce phénomène d’innovation ecclésiologique attributive récemment né s’explique désormais sans grande difficulté, du fait que inconsciemment, depuis que le centre de gravité ecclésiologique, de territorial qu’il était, est devenu confessionnel, nous avons remplacé la désignation locale par une épithète déterminante qui correspond à des expériences ecclésiologiques divergentes. Si nous utilisons des catégories d’épithètes, c’est parce que nous sommes mus précisément par ce même besoin d’auto-désignation qui impose l’emploi de catégories d’épithètes confessionnels. Toutefois, pour l’Ecclésiologie, il n’existe ni Eglise ritualiste ni Eglise confessionnelle, ni Eglise ethnico-ethnophylétique respectivement.
Même s’il peut paraître équivalent (isomorphique) de parler par exemple d’Eglise de Roumanie ou d’Eglise roumaine, et bien que la différence de terminologie semble bien superficielle, nous devons constater, d’après ce que l’on a vu plus haut, qu’elle est réellement significative entre l’usage d’un nom de lieu et l’usage à la légère d’un attributif distinctif, car les intentions, soit ecclésiologiques, soit divergentes et hétéro-centriques renvoient à deux conceptions différentes de l’Eglise. L’Eglise est communion et non divergence. Le fossé qui sépare ces deux conceptions est large, aussi large que celui qui existe entre l’“ecclésiologique” et le “non ecclésiologique”…
* * * * *
Ces trois ecclésiologies divergentes, qui se sont développées tout au long des huit derniers siècles du deuxième millénaire (13e-20e siècles), ont en fait ouvert pour l’Eglise l’époque de la post-ecclésiologie. Telle est l’époque que nous traversons, une époque où l’on tente de donner des solutions superficielles, soit par des conciles tels que Vatican II qui a préconisé l’élargissement de l’œcuménisme, soit par une tentative accrue de fédéralisation des Eglises protestantes, soit par la lutte infructueuse pour convoquer un Concile panorthodoxe, préparé, sans résultat, depuis bientôt un demi-siècle. Il est certain que la solution ne pourra être ni ritualiste ni œcuméniste, elle ne sera ni confessionnelle ni fédérative et sûrement pas ethno-phylétique et multi-juridictionnelle ; elle ne pourra qu’être ecclésiologique et canonique, et c’est peut-être pourquoi elle paraît très lointaine, sinon utopique, à l’époque post-ecclésiale que nous traversons et qui s’est instaurée comme l’époque du Christianisme moderniste, un Christianisme qui demeure tragiquement multilatéraliste et nullement ecclésiologique.
Dans cette approche comparatiste de la question, nous pourrions ajouter que l’émergence de la Réforme a imposé une situation de facto de co-territorialité et que, là où existait une Eglise (Patriarcat) d’Occident, a été créé, après les guerres de religion et, beaucoup plus tard, à la naissance de l’œcuménisme, l’évident et incontestable acquis — l’évidence irréversible — de la co-territorialité de l’ecclésiologie contemporaine. Depuis lors, la co-territorialité se transforme exclusivement en situation ecclésiologique de facto pour tous et en donnée ecclésiologique pérenne, acceptées à l’unanimité, au point de devenir finalement un élément constitutif de l’expression territoriale de toute Eglise et Confession chrétiennes établies localement. C’est ainsi qu’aujourd’hui, elle constitue la caractéristique commune et fondamentale de toutes les ecclésiologies des Eglises chrétiennes :
- Pour l’Eglise catholique, citons un exemple : à Jérusalem, cinq Patriarcats catholiques co-existent, gouvernés par deux Codes de Droit canonique unilatéraux[xv]. Dans le même contexte que celui sous-tendant le problème ecclésiologique de la co-territorialité s’inscrit également l’émergence de l’Uniatisme, ainsi que la volonté tenace de Rome d’en préserver l’existence…
- Les Eglises protestantes se multiplient en un même lieu et à travers le monde, et tentent de résoudre le problème par des fédéralisations.
- Pour les Eglises orthodoxes établies localement, citons aussi un exemple : à Paris, six évêques orthodoxes co-existent, dont les juridictions ecclésiastiques équivalentes ou synonymes – et même parfois homonymes – se chevauchent (malgré l’interdiction explicite édictée par le Ier Concile œcuménique de Nicée [325][xvi] et le IVe Concile œcuménique de Chalcédoine [451][xvii]), et les Eglises établies localement présentent aussi toutes les données statutaires de co-territorialité mentionnées plus haut.
- À ces quelques exemples représentatifs, on pourrait ajouter l’ecclésiologie du Conseil Œcuménique des Eglises (COE), pour lequel la coexistence pluraliste constitue un critère ecclésiologique essentiel, sans parler, bien sûr, de la communion des Eglises anglicanes, des Eglises arméniennes et de l’Eglise Catholique Orthodoxe de France (ECOF), mais aussi
- Dans les 17 Eglises différentes des Vieux Calendaristes en Grèce, qui présentent, à un degré étonnamment élevé, ce même symptôme caractéristique de la double co-territorialité (extérieure, par rapport à l’Eglise orthodoxe de Grèce, mais aussi intérieure, par rapport aux 17 “Vrais (sic) Eglises Orthodoxes de Grèce” homonymes et autoproclamées), sans oublier l’Eglise russe hors-frontières avec une juridiction ecclésiastique universelle et un comportement par définition de co-territorialité.
Par conséquent, pour les Eglises, le problème n’est pas ritualiste, confessionnel ou ethno-phylétique, mais concerne avant tout l’Ecclésiologie et la communion ontologique des Eglises en Christ.
Remarques-Conclusions
Jamais, dans l’Histoire deux fois millénaire du Christianisme, l’Ecclésiologie de l’Eglise n’a connu d’aliénation aussi générale et d’une telle portée, qu’au cours des huit derniers siècles (13e-20e siècles), en cette époque que nous pouvons qualifier comme “post-ecclésiologique”. Nous en portons tous la responsabilité, Catholiques, Protestants et Orthodoxes. L’organisation selon un code de droit canonique, un rite, une confession ou des statuts nationaux des Eglises a, systématiquement et consciemment, ignoré et ignore encore totalement la tradition ecclésiologique canonique, issue de la praxis ecclésiastique vitale de l’Eglise du Christ, du Nouveau Testament, des Conciles œcuméniques et locaux et des Pères. Elle s’inspire à tort de données et de conditions propres à l’époque éonistique “post-ecclésiologique”, sans laisser la moindre possibilité, ni manifester la moindre volonté de trouver le chemin du retour vers « d’où nous sommes tombés »[xviii].
Au terme de cette analyse, s’il en est vraiment ainsi, pour nous résumer, nous constatons que les Croisades ont effectivement créé une nouvelle situation ecclésiastique de facto qui, depuis, a influencé – pour ne pas dire imposé – l’Ecclésiologie et son sens. La Réforme a aggravé le problème de la co-territorialité ecclésiologique, qui avait pris naissance dès les Croisades (1ère Croisade-1099). Le trait principal de cette nouvelle organisation ecclésiologique était la fondation d’Eglises non plus territoriales, mais co-territoriales. D’où le problème ecclésiologique de la co-territorialité. En d’autres termes, des Eglises non plus en plénitude de communion mais en coexistence avec d’autres Eglises. Des Eglises dont le fondement n’est plus ecclésiologique, mais ritualiste, confessionnel ou ethno-phylétique (conviventia ritualiste, confessionnelle et ethno-phylétique). Un fondement ritualiste, confessionnel ou ethno-phylétique cependant, qui détermine et dicte les Codes de Droit canonique, les textes officiels des Confessions protestantes, les Chartes statutaires, mais aussi l’ecclésiologie qu’ils sous-tendent. Tout cela constitue l’image et les caractéristiques de l’époque “post-ecclésiologique” qui, à l’heure actuelle, culmine et prospère.
De cette brève recherche, il ressort que, dans les Temps Modernes, l’ecclésiologie orthodoxe a été davantage influencée par l’ecclésiologie protestante lorsqu’elle s’est définie et affirmée que par l’ecclésiologie catholique, du fait que cette dernière présente une structure ecclésiastique unidimensionnelle à l’échelle mondiale, suite à la rupture de communion survenue en 1054 et au développement ecclésiologique ultérieur se fondant sur l’existence d’un seul Patriarcat-Eglise pour le monde entier. C’est peut-être cela qui explique aussi la coexistence facile des Orthodoxes et des Protestants au Conseil Œcuménique des Eglises (COE), qui peut être considéré comme le couronnement de l’époque post-ecclésiologique.
Il serait possible de représenter cette époque post-ecclésiale dans le tableau suivant :
L’Ecclésiologie à l’époque post-ecclésiologique
- Eglise catholique : Poly-ritualisme ; Co-territorialité :
• Extérieure : Fondation d’Eglises sur le territoire d’autres Eglises (conviventia intraecclésiale).
• Intérieure : Eglises sous forme de rite, acceptation de l’Uniatisme et recouvrement territorial mutuel en un même lieu (conviventia ritualiste-intracatholique).
- Eglises protestantes : Multi-confessionalisme ; Co-territorialité :
• Extérieure : Fondation d’Eglises sur le territoire d’autres Eglises dès le jour de leur naissance confessionnelle (conviventia intraecclésiale).
• Intérieure : Eglises sous forme de multiplication informelle des Communautés et recouvrement territorial mutuel en un même lieu (conviventia confessionnelle-intraprotestante).
- Eglises orthodoxes établies localement : Multi-juridiction ; Co-territorialité :
• Extérieure : Ø
• Intérieure : Eglises et juridictions ecclésiastiques sous forme de multi-juridiction ethno-phylétique et culturelle et recouvrement territorial mutuel en un même lieu (conviventia ethnophylétique-intraorthodoxe).
Voilà le puzzle illustrant le sens, les caractéristiques et les perspectives de l’époque “post-ecclésiologique”…
Encore une remarque. De ces trois ecclésiologies :
- L’Eglise catholique n’a jamais condamné l’ecclésiologie ritualiste (qui est née au 13e siècle) comme déviante par rapport à l’Ecclésiologie de l’Eglise. Bien au contraire, le Ritualisme ecclésiologique continue à inspirer les Eglises catholiques de rites divers et à déterminer leur naissance.
- Les Protestants non plus n’ont jamais condamné l’ecclésiologie confessionnaliste (qui est née au 16e siècle) comme déviante par rapport à l’Ecclésiologie paulinienne. Bien au contraire, le Confessionnalisme ecclésiologique continue à inspirer les Eglises protestantes et à déterminer leur naissance.
C’est donc à l’absence de condamnation de toute sorte (conciliaire ou autre) que ces Eglises, quoiqu’elles ne se justifient pas théologiquement, doivent en quelque sorte de ne porter aucune responsabilité…
- Les Orthodoxes, pour leur part, lorsque l’ecclésiologie ethno-phylétique a commencé à fleurir et prospérer (elle est née au 19e siècle, dès l’émergence des Nations-Etats), ont immédiatement convoqué un Concile panorthodoxe à Constantinople et ont condamné l’Ethno-phylétisme ecclésiologique comme hérésie (1872). De tous les Chrétiens, seuls les Orthodoxes ont eu le courage théologique de se mobiliser synodalement et de condamner comme hérésie une telle forme de déviance ecclésiologique, ce qui montre l’acuité de la sensibilité ecclésiologique qui les animait, tout du moins à ce moment-là. Toutefois, depuis ce Concile, la quasi-totalité des Eglises nationales orthodoxes n’ont rien d’autre à montrer, statutairement et canoniquement, qu’une ecclésiologie ethno-phylétique, c’est-à-dire, statutairement parlant, l’hérésie qu’elles avaient peu auparavant condamnée conciliairement. Ainsi, de nos jours, tous se comportent de manière ethno-phylétique, agissent de manière ethno-phylétique, organisent leur “diaspora ethno-ecclésiastique” (sic) et, jusqu’à aujourd’hui (20e siècle), s’organisent de manière ethno-phylétique.
C’est pourquoi, contrairement aux Catholiques et aux Protestants, les Orthodoxes seront inexcusables d’avoir aujourd’hui adopté un comportement anti-ecclésiastique, malgré les décisions et recommandations conciliaires ad hoc, contribuant ainsi à la fragmentation du corps ecclésial partout où celui-ci est invité à être constitué sur la terre.
Voilà justement ce qui atteste clairement que l’époque que nous traversons est de toute évidence post-ecclésiologique, au moment où on sait très bien que l’Ecclésiologie concerne le mode d’existence de l’Eglise. Et s’il en est vraiment ainsi, à une époque où tous (Catholiques, Protestants et Orthodoxes) parlent d’une Ecclésiologie eucharistique, une question se pose : à l’époque où l’Ecclésiologie n’est pas correcte, à quel point l’Eucharistie est-elle possible ? En tout cas, pour les Pères de l’Eglise, lorsque la foi n’était pas correcte, l’Eucharistie était impossible ! Qu’en est-il donc de l’Ecclésiologie ?…
En fin de compte, la pathologie des trois ecclésiologies que nous avons examinées est commune, malgré quelques différences dans la théologie ou la confession ou encore dans l’Eglise, si bien que, ce qui est dit de la pathologie de l’ecclésiologie d’une Eglise est, d’une manière générale, également valable pour l’ecclésiologie des autres Eglises, avec tout ce qui en découle, toutes proportions gardées sauf le respect des particularités spécifiques des unes et des autres. Par conséquent, il s’agit de trois ecclésiologies-“sœurs” (par analogie avec les Eglises-“sœurs”), dont les caractéristiques se croisent et se répondent, et non pas d’ecclésiologies en communion, parce que tout simplement ces caractéristiques sont réparties de part et d’autre. Trois ecclésiologies “sœurs” donc, mais qui n’ont rien à voir avec l’Ecclésiologie de l’Eglise… Il faudrait …réécrire le Nouveau Testament pour pouvoir justifier théologiquement les ecclésiologies chrétiennes contemporaines…
* * * * *
Aujourd’hui, dans notre société multiculturelle, les revendications culturelles s’entendent davantage que les réponses ontologiques très faibles des Eglises. Les Eglises devront choisir, à l’avenir, si elles conserveront l’Ecclésiologie paulinienne néo-testamentaire qui a guidé l’Eglise durant quinze siècles ou si elles cèderont aux revendications confessionnelles, ritualistes, culturelles ou ethniques de l’époque post-ecclésiologique, qui ont été incontestablement consacrées comme ecclésiologie – ayons le courage de le dire – du passé et, selon toute apparence, du futur. Dans le second cas, l’Eglise du Christ deviendra la cinquième roue du carrosse dans la tragique marche éonistique des peuples – et cela, par la faute des Eglises – et non pas le leader sur la voie déjà tracée par la Résurrection de leur cheminement eschatologique[xix]…
* * * * *
Le vote de la France et de la Hollande lors du référendum européen (29-5 et 31-5-2005 respectivement) nous a démontré que des peuples, qui se sont libérés du nationalisme et d’un étatisme inflexible, des peuples tenant un rôle de leader dans le devenir européen et l’idée européenne, des peuples qui ont combattu sincèrement le passé nationaliste en Europe, ne sont finalement pas parvenus à lui échapper… Comment donc y seraient parvenus et y parviendraient ceux qui ne s’en sont jamais libérés… Et que non seulement les Européens ne s’en sont pas libérés, mais, jusqu’à cet instant, ils surenchérissent, par un moyen ecclésiastique institutionnel ou un autre, en affirmant que c’est l’idée de la Nation-Etat, autrement dit le nationalisme d’Etat ou mieux le nationalisme phylétique, qui détermine l’ecclésiologie de l’Eglise et le règlement canonique de toute question ecclésiologique. En ce cas, la voix des canons de l’Eglise et de son Ecclésiologie est très faible face au puissant écho des Chartes statutaires ethno-phylétistes orthodoxes actuelles. C’est pourquoi cette voix n’est pas entendue dans le tumulte qu’émet, en cette époque post-ecclésiologique, l’écho déformé de l’Ecclésiologie…
[i] Par ritualisme, nous entendons les différents rites (les anciennes traditions liturgiques) qui continuent de co-exister au sein de l’Eglise catholique romaine et qui instituent des groupes religieux ou des entités ecclésiales en principe parallèles, superposés et universels.
[ii] Voir notre article intitulé “L’époque de la Xénocratie à Chypre (1191-1960)-Note historico-canonique”, in Hydor ek Pétras [Crète], vol. xii-xvi (2000), p. 205-209.
[iii] Voir notre article intitulé “La relation oppositionnelle de l’Eglise locale et de la ‘Diaspora’ ecclésiastique (L’unité ecclésiologique face à la ‘co-territorialité’ et à la ‘multi-juridiction’)”, in Synaxie, vol. 90 (4-6/2004), p. 28-44 (en grec). De même, “La relation d’opposition entre Eglise établie localement et ‘Diaspora’ ecclésiale (L’unité ecclésiologique face à la ‘co-territorialité’ et la ‘multi-juridiction’)”, in L’Année canonique [Paris], t. 46 (2004), p. 77-99, in Contacts, t. 57, n° 210 (4-6/2005), p. 96-132, in Ast. Argyriou (Textes réunis par), Chemins de la Christologie orthodoxe, Paris, Desclée (coll. Jésus et Jésus-Christ, n° 91), 2005, XX, p. 349-379, et in Archim. Grigorios D. PAPATHOMAS, Essais de Droit canonique orthodoxe, Florence, Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” (coll. “Seminario di Storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e Chiesa-Reprint Series”, n° 38), 2005, chap. II, p. 25-50.
[iv] C’est le jus soli.
[v] C’est le jus sanguinis.
[vi] Article 2 de la Charte statutaire de l’Eglise de Chypre. Voir le texte de l’édition primeur dans la Revue Apostolos Barnabas, 3e période, t. 40, n° 11 (11/1979), p. 407-512 (en grec). De même, en français, dans Archim. Grigorios D. Papathomas, L’Eglise autocéphale de Chypre dans l’Europe unie (Approche nomocanonique), Thessalonique-Katérini, Ed. Epektasis (coll. Bibliothèque nomocanonique, n° 2), 1998, p. 229 ; souligné par nous.
[vii] Probablement, il fait référence aux fidèles orthodoxes.
[viii] Souligné par nous.
[ix] C’est dans ce même esprit que le Patriarcat de Russie a si facilement accordé les promesses récentes dans tous le sens (Europe occidentale, Estonie, Eglise russe “hors-frontières”, etc.) pour une “large (sic) autonomie” ecclésiastique. Un événement récent explique cet état d’esprit. Au sujet de rétablissement de l’unité entre le Patriarcat de Russie et l’ Eglise russe “hors-frontières”, quatre documents ont été rendus publics. « Il ressort de ces documents publiés que les responsables actuels de l’ Eglise russe “hors-frontières” abandonnent tous les griefs qu’ils faisaient auparavant au Patriarcat de Moscou. […]. En echange de sa reconnaissance de la juridiction du Patriarcat de Moscou, l’Eglise russe “hors-frontières” obtient “par souci d’économie” un statut d’“auto-administration”, lui permettant de continuer à exister en tant que structure ecclésiale particulière dans les différentes parties du monde où elle est implantée, parallèlement aux structures diocésaines du Patriarcat de Moscou déjà existantes sur ces mêmes territoires » (SOP, n° 300 (7-8/2005), p. 21-22 ; souligné par nous).
[x] Cf. Gal. 4, 4.
[xi] Le terme de “diaspora” (sic) est erroné pour désigner des territoires dont l’Eglise voulait qu’ils soient et constituent des Eglises locales. Jusqu’à aujourd’hui, cela reste un problème ecclésiologique que nous avons quelque peu abordé dans une précédente publication (voir notre article, op. cit.). Il serait bon d’y ajouter quelque chose. Quand l’Eglise accepte, du point de vue ecclésiologique, le terme étrange à sa nature de “diaspora” – et maintenant incontestablement accepté par tous – pour désigner le Corps du Christ, son propre Corps, c’est comme si elle donnait priorité, non pas à la raison eschatologique de l’existence de l’Eglise du Christ, mais au centre ecclésiastique national d’un peuple, et donc à l’Etat national qui le représente. Et ce phénomène a pris son origine à l’époque où nous avons commencé à avoir des Eglises nationales, et non de l’époque des Villes-Patriarcats. Autrement dit, tout corps ecclésial qui donne priorité au centre étatique national d’un peuple, et non à sa vision eschatologique commet une erreur théologique… Et pour l’Eglise, il n’existe pas d’autres centres que l’autel de chaque Eglise locale à travers le monde…
[xii] 1 Cor 1, 2 ; 2 Cor 1, 1.
[xiii] Gal 1, 2.
[xiv] Extrait de notre article op. cit., in Synaxie, vol. 90 (4-6/2004), p. 32-33, in L’Année canonique [Paris], t. 46 (2004), p. 81-82, in Contacts, t. 57, n° 210 (4-6/2005), p. 102-103, et in Archim. Grigorios D. PAPATHOMAS, Essais de Droit canonique orthodoxe, chap. II, p. 29-30.
[xv] La pathologie de l’Ecclésiologie de l’Eglise catholique se manifeste dans l’existence de deux Codes de Droit canonique, le Code latin et le Code oriental, qui admettent la co-territorialité ritualiste et culturelle (du statut personnel) comme un a priori ecclésiologique dans la fondation d’une Eglise ou d’une Communauté ecclésiale, indépendamment de la préexistence d’une autre Eglise, non seulement d’une autre confession, mais aussi de la même confession ou du même rite. À notre avis, la coexistence de deux codes, indépendants l’un de l’autre (cf. mariage des prêtres, interdit par l’un et accepté par l’autre selon un critère purement géoculturel, etc.), correspond pleinement à l’esprit de l’époque post-ecclésiologique. Il était inconcevable pour tout Concile de l’Eglise, œcuménique ou local, de formuler deux catégories de dogmes ou deux catégories de canons, destinés à deux catégories différentes de personnes, selon des critères culturels, ritualistes ou confessionnels, ainsi qu’il est advenu lors de Vatican II. En ce sens, Vatican I, qui a publié un Code, était plus progressiste que Vatican II qui en a publié deux, qui en plus sont divergents. Or ici il ne s’agit pas d’inculturation, mais d’un traitement discriminatoire des fidèles et des peuples. Néanmoins, il est vrai que Vatican II a fait de nombreux efforts, et parmi eux, de grands efforts positifs, pour se sortir de la situation désastreuse que l’époque post-ecclésiologique a imposée et impose encore inéluctablement. L’adoption de deux Codes, qui de plus sont unilatéraux et indépendants l’un de l’autre, montre qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que l’Eglise catholique résolve le problème ecclésiologique de la co-territorialité, d’abord en son sein puis au-delà, par une coopération œcuménique avec les autres Eglises.
[xvi] Canon 8/Ier : « […], qu’il n’y ait point deux évêques dans une même ville » ; souligné par nous.
[xvii] Canon 12/IVe : « Nous avons appris que certains, agissant en opposition avec les institutions de l’Eglise, s’adressent aux pouvoirs publics pour faire diviser une province en deux par des lettres pragmatiques impériales, si bien qu’à partir de ce moment-là, on peut voir deux métropolites coexister dans une même province ecclésiastique. Le saint concile décrète qu’à l’avenir aucun évêque ne devra oser agir ainsi, et que s’il le fait, ce sera à ses propres risques. […] » ; souligné par nous.
[xviii] Cf. Ap. 2, 5.